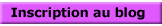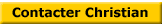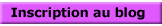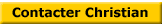Dans un article récent :
Qui osera censurer le Conseil constitutionnel ?
Je relayais la Lettre patriote qui émettait une sévère critique de l’instance suprême de notre système judiciaire.
Dans deux décisions successives, le Conseil constitutionnel vient de démontrer sa prise en compte, à géométrie variable, du principe de précaution inscrit dans la Constitution.
En invoquant ce principe, il interdisait la réintroduction d’un pesticide utilisé dans la culture de la betteraves, pesticide autorisé dans les autres pays d’Europe.
Mais en le négligeant totalement, il s’opposait à la prolongation, au delà de 90 jours, en centre de détention des détenus sous OQTF réputés dangereux, au mépris, donc, de la sécurité des Français !
Devant tant « d’injustice », allais-je écrire, certains demandent la suppression du Conseil constitutionnel ! Pour ma part, je me limiterai à demander une réforme limitant son périmètre d’intervention, sa latitude d’interprétation et surtout le mode de nomination de ses membres.

Voici un article de l’IREF qui pose le problème du maintien ou de la suppression de ce juges :
La justice constitutionnelle est une nécessité
dans une démocratie libérale
Si la composition et certaines décisions du Conseil constitutionnel peuvent être critiquées à raison, vouloir renoncer à tout contrôle de constitutionnalité des lois serait une grave erreur, estime Jean-Philippe Feldman, agrégé des facultés de droit.
À entendre les discours rituels contre le Conseil constitutionnel, la cause est entendue : il n’est autre qu’un «gouvernement des juges», dénué de légitimité et qui ose s’opposer à la volonté du «peuple» exprimée par nos parlementaires et avant tout par nos députés. En conséquence, cette petite élite, déconnectée de la réalité et qui fait plus de la politique que du droit, doit être mise au pas afin que la démocratie et la souveraineté populaire priment de nouveau.
Certes, le Conseil constitutionnel est reprochable. On peut parler d’un quasi-consensus chez les constitutionnalistes pour dénoncer sa composition, baroque par rapport à celle de nos voisins : les membres dits de droit que sont les anciens présidents de la République, même si depuis quelques années la règle est largement formelle ; l’absence de conditions, notamment en termes d’études et de carrière juridique, pour être membre nommé. Le Conseil est aujourd’hui unique dans son genre : pas de professeur des facultés de droit, peu de juristes, un tir groupé d’anciens fonctionnaires et/ou hommes politiques professionnels. La polémique autour de l’actuel président de l’institution, formé juridiquement durant deux petites années en faculté, serait inimaginable dans la plupart des États de droit.
Ce n’est pas tout. Certains quotidiens de gauche n’ont pas manqué de railler les hommes politiques de droite qui s’étaient récriés devant les dernières décisions du Conseil, alors même que ce sont des gouvernants de droite et du centre qui l’ont créé, puis renforcé. Qui, en effet, a érigé le Conseil en 1958 ? Qui en avait désigné les membres et notamment le président, eux qui ont rendu au début des années 1970 des décisions fondées sur ce que l’on a appelé le bloc de constitutionnalité ? Qui a élargi successivement les autorités de saisine avec le contrôle de constitutionnalité des voix ouvert aux parlementaires, puis aux simples justiciables avec la question prioritaire de constitutionnalité ?
Le problème des textes de référence est également central et on peut poser une nouvelle question : qui a fait entériner la charte de l’environnement, si ce n’est Jacques Chirac ? Quelques mauvaises langues ont relevé que Laurent Wauquiez, à la pointe du combat contre le Conseil ces derniers temps, n’avait pas hésité à voter en faveur du texte constitutionnel en 2005…
Oui, le corpus sur lequel s’appuie le Conseil constitutionnel est défectueux et il lui donne une latitude d’interprétation plus qu’excessive. N’oublions pas qu’il appartient aux juristes en général et aux juges en particulier d’interpréter les textes. Et comme l’écrivait joliment Jean Giraudoux :
le droit est la plus puissante école de l’imagination. Jamais poète n’a interprété la nature aussi librement qu’un juriste la réalité.
Mais on comprend bien que si l’on multiplie les textes, au surplus contradictoires, on centuple par là même les ressorts à la disposition des juges. Or, le préambule de la Constitution de 1958 se réfère non seulement à la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, d’inspiration libérale nonobstant son légicentrisme, mais également au préambule de la Constitution de 1946, d’inspiration marxiste.
Lorsqu’il a rendu, dans le contexte du socialisme triomphant, sa grande décision de 1982 sur les nationalisations, le Conseil a choisi de ne pas faire primer un texte sur l’autre, mais de concilier les droits. La défense du droit de propriété en est venue à voisiner avec sa violation ! Les choses se sont aggravées avec l’adoption de la charte de l’environnement dont l’inspiration, là encore, n’est guère libérale, à commencer par son sulfureux principe de précaution.
Pour autant, le bébé doit-il être jeté avec l’eau du bain ? Autrement dit, la justice constitutionnelle doit-elle disparaître ou, du moins, être marginalisée au profit de la «souveraineté de peuple» ?
Ce serait une grave erreur !
Les principes fondamentaux posés par les grands constitutionnalistes libéraux du XIXe siècle , à commencer par Benjamin Constant et son disciple Édouard Laboulaye, n’ont pas pris une ride. À leur base se trouve une définition bien particulière de la Constitution. Celle-ci ne se conçoit pas comme un simple document technique qui organise des fonctions entre des organes plus ou moins interdépendants, comme le pensent les juristes positivistes et socialistes. Elle se comprend avant tout comme un instrument contre l’arbitraire, une garantie de la liberté, un moyen d’enserrer le pouvoir afin qu’il n’empiète pas sur la sphère des individus et de la société civile.
Dès lors, et contrairement aux lieux communs actuels des populistes de tous poils, il ne saurait y avoir, d’une part, d’absoluité de la souveraineté populaire et, d’autre part, de délégation, encore moins de captation à leur profit, de cette souveraineté par les parlementaires, qui ne se situent donc pas au-dessus de la Constitution.
C’est ce qu’avaient déjà compris les Pères fondateurs de la Constitution américaine dans les années 1770-1780. En effet, ils avaient pu constater après la proclamation de l’Indépendance les effets délétères de la « souveraineté parlementaire », entre corruption, passe-droits et démagogie, dans les assemblées des anciennes colonies anglaises d’Amérique. Aussi ont-ils inventé le contrôle de constitutionnalité des lois, avant d’interdire carrément au Congrès des États-Unis de faire des lois dans certaines matières.
Contrairement là encore aux lieux communs actuels des populistes, la démocratie n’est pas toujours un bien : elle peut verser dans la tyrannie. Et la justice constitutionnelle représente justement un frein à la démocratie tyrannique. Ce frein est un élément essentiel de la démocratie libérale, à laquelle nous devons tenir comme à la prunelle de nos yeux.
Jean-Philippe Feldman pour l’IREF.
Merci de tweeter cet article :