
Oui, demain, une simple salade pourrait vous vacciner …
… sans seringue, sans médecin et peut-être même sans que vous le sachiez.
L’ARN messager, cette technologie utilisée dans les vaccins anti-covid, s’invite dans nos assiettes, les élevages et les cultures, transformant silencieusement le vivant.
Liberté, sécurité, consentement : que reste-t-il de tout cela quand la nourriture devient un outil biotechnologique ?
C’est le thème d’un article de fond proposé par The Epoch Times :
« Hommes, animaux, plantes … Plus rien n’échappe à l’ARN messager » : le livre choc du Dr Sabatier et d’Estelle Fougères sur une « dérive biotechnologique » en gestation
L’article étant passionnant, inquiétant et très long, je vous en propose un résumé réalisé avec l’aide de ChatGPT :
Vacciné avec une simple salade !
L’article du Epoch Times, inspiré du livre Vaccins à ARN messager, la grande transformation du vivant de Jean-Marc Sabatier et Estelle Fougères, examine l’extension de la technologie de l’ARN messager (ARNm) au-delà de la vaccination humaine, vers le monde animal et végétal. Les auteurs y voient une mutation biotechnologique majeure, mais silencieuse, soulevant selon eux d’importants enjeux éthiques, sanitaires et démocratiques.
1. Une technologie désormais appliquée au vivant non humain
Sabatier et Fougères expliquent que l’ARN messager, utilisé initialement contre le Covid-19, se déploie aujourd’hui dans les élevages et les cultures. Cette évolution passe souvent inaperçue du grand public, notamment parce que la vaccination animale est permise y compris en agriculture biologique. Les auteurs s’interrogent sur la transparence des pratiques et réclament, à l’image des OGM, une mention claire pour les produits issus d’animaux ou de plantes vaccinés à l’ARNm.
2. Une redéfinition du mot “vaccin”
Selon eux, les produits à ARNm ne correspondent pas aux vaccins traditionnels, mais à des thérapies géniques modifiant temporairement le fonctionnement cellulaire. Ils soulignent qu’en 2021, la définition officielle du mot « vaccin » a changé : on ne parle plus d’un produit conférant une immunité, mais stimulant la réponse immunitaire — un glissement sémantique qui, selon eux, affaiblit les exigences de protection et de contrôle. Le classement de ces produits comme « vaccins » plutôt que « thérapies géniques » aurait aussi permis d’alléger les tests réglementaires (biodistribution, génotoxicité, etc.).
3. Vers de nouveaux modes d’administration
Les chercheurs évoquent l’émergence de vaccins à ARNm sous forme de comprimés, sprays nasaux ou patchs cutanés. Si ces méthodes visent à simplifier la vaccination, Sabatier et Fougères alertent sur leurs incertitudes : dégradation de l’ARN dans l’organisme, effets imprévisibles sur les muqueuses, risques neurologiques liés aux nanoparticules, ou dosage incontrôlé des patchs. Ils estiment que ces innovations, encore peu étudiées, reposent sur une logique de commodité au détriment de la sécurité biologique.
4. Les vaccins à ARN messager auto-amplifiants
L’article consacre une large part à cette nouvelle génération de vaccins, dits auto-amplifiants, dont un premier exemplaire (ARCT-154, ou Kostaive) a été autorisé au Japon en 2023 et par l’Union européenne en 2025. Ces vaccins contiennent une séquence génétique additionnelle codant pour une enzyme « réplicase », capable de copier l’ARN à l’intérieur des cellules, amplifiant ainsi la production d’antigènes.
Cette technologie permettrait des doses plus faibles et une immunité prolongée, mais selon Sabatier et Fougères, elle pose des questions essentielles : jusqu’où l’ARN se réplique-t-il ? Peut-il entraîner une production continue d’antigènes, favorisant des inflammations chroniques ou des troubles auto-immuns ? Les auteurs estiment que ces inconnues justifient une prudence accrue avant toute généralisation.
5. La vaccination des canards contre la grippe aviaire
En France, depuis 2023, les élevages de plus de 250 canards sont soumis à une vaccination obligatoire. Deux vaccins sont utilisés :
-
VOLVAC B.E.S.T. AI + ND, basé sur une technologie classique ;
-
CEVA Respons AI H5, fondé sur l’ARN messager auto-amplifiant.
Selon les auteurs, ce dernier est utilisé sans recul scientifique suffisant. Ils redoutent une possible persistance des ARN dans la viande, notamment lors de cuissons douces (magret rosé, foie gras mi-cuit), certains ARN pouvant résister à la chaleur. Des additifs comme le squalène ou les nanoparticules d’oxyde ferrique pourraient, selon eux, stabiliser ces molécules et permettre leur passage dans l’organisme humain — un scénario hypothétique mais jugé plausible.
Ils dénoncent un manque de transparence : le consommateur ignore quel vaccin a été administré, et les autorisations temporaires d’utilisation du vaccin CEVA ont été révisées à plusieurs reprises, avec des avertissements concernant sa manipulation, ses effets secondaires et l’absence de données d’innocuité pendant la ponte.
6. Vers une ingénierie du vivant globalisée
Les auteurs élargissent leur critique au développement de projets biotechnologiques visant à modifier les fonctions physiologiques des animaux — par exemple, réduire les émissions de méthane des vaches via des thérapies géniques ou des additifs digestifs. Ils mentionnent aussi des dispositifs tels que le programme ZELP, qui équipe les bovins de masques pour capter le méthane.
Pour eux, ces initiatives incarnent une « fuite en avant technologique » où le vivant devient un objet de régulation et de contrôle intégral au nom de la lutte contre le changement climatique.
7. Les “légumes vaccinaux” : la vaccination comestible
L’article retrace l’histoire des « plantes vaccinantes », une idée née dans les années 1990, consistant à insérer des gènes viraux dans des végétaux (pomme de terre, tomate, banane) pour provoquer une immunité après ingestion. Aujourd’hui, cette approche refait surface sous forme de plantes produisant de l’ARN messager vaccinal, comme les laitues ou les épinards étudiés à l’université de Californie à Riverside.
Une laitue pourrait théoriquement contenir une dose suffisante pour « vacciner » une personne.
Mais Sabatier et Fougères pointent de nombreuses limites : dosage incontrôlable, dégradation de l’ARN par la cuisson ou la digestion, effets inconnus d’une exposition répétée. Ils posent une question centrale : où s’arrête la nourriture, où commence le médicament ? Pour eux, cette approche brouille la frontière entre alimentation et thérapie et menace la liberté de choisir ce que l’on consomme.
8. Une critique du dogme vaccinal
Enfin, les auteurs rejettent l’étiquette d’« antivax ». Ils disent reconnaître l’utilité de la vaccination lorsqu’elle est fondée sur la preuve et le consentement éclairé, mais dénoncent une dérive « dogmatique ». Selon eux, la crise du Covid-19 a transformé la vaccination en symbole moral et en « religion séculière », où le doute scientifique est assimilé à une faute.
Ils appellent à restaurer la prudence, la transparence et la liberté de choix, estimant que la confiance du public ne peut renaître qu’à travers le débat ouvert et la rigueur scientifique.
Ils rappellent enfin que Pasteur lui-même distinguait la foi de la science : « Lorsque je rentre dans mon laboratoire, je laisse ma foi au vestiaire. »
Synthèse
L’article dresse donc un tableau critique de la généralisation des vaccins à ARN messager au-delà de la santé humaine : leur application au monde animal et végétal, leur requalification juridique, et leur transformation en produits alimentaires ou environnementaux.
Pour les auteurs, cette évolution marque un tournant : la technologie de l’ARNm ne serait plus seulement un outil médical, mais un instrument de transformation du vivant, engagé sans transparence ni débat démocratique. Ils appellent à la vigilance face à cette « médecine furtive » qui, sous couvert d’innovation, pourrait redéfinir la relation entre science, nature et liberté individuelle.
Conclusion
L’innovation est fascinante, mais où s’arrête le progrès et où commence le contrôle du vivant ? Avant que notre assiette ne devienne un outil médical ou environnemental, il est urgent de poser les limites et de réclamer transparence et débat public.
Article initial de The Epoch Times, résumé par ChatGPT.


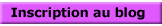
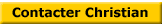
Suivre @ChrisBalboa78
Une réponse à “Un jour, une simple salade pourrait bien vous vacciner”



Jenner a pris des risques avec son injection de variole atténuée, Pasteur pour la rage.
Sur certaines tombes romaine est gravée ces lettres NF,F, NS, NC.
Non fui, fui, non sum, non curo. Je n’étais pas, je fus, je ne suis plus, je n’en ai cure.
Une société qui refuse le risque par peur de la mort est une société moribonde qui ne demande qu’à disparaître.