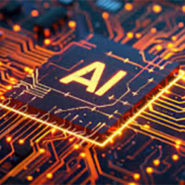
Chaque année, le Forum Économique Mondial publie sa sélection des dix technologies émergentes appelées à transformer nos sociétés.
Sous couvert de progrès, ce rapport dresse le portrait d’un futur pensé par une organisation non élue, pourtant au cœur du pouvoir mondial. Derrière la transparence affichée et une rhétorique humaniste, se dessine une trajectoire qui pourrait l’être un peu moins …
Vous venez de lire l’introduction d’un article de La Sélection du Jour consacré aux travaux du Forum de Davos. En voici la suite :
Les 10 technologies qui vont changer le monde,
selon de Forum économique mondial
Créé en 1971 par l’économiste allemand Klaus Schwab (qui a récemment dû démissionner), le FEM se présente comme une fondation à but non lucratif, visant à « améliorer l’état du monde » par la coopération entre public et privé. Chaque année, son sommet de Davos réunit chefs d’État, multinationales, ONG et experts. Une scène ultra influente mais sélective, car seules les entreprises réalisant plusieurs milliards de chiffre d’affaires peuvent espérer y participer, moyennant des frais d’adhésion qui peuvent dépasser 250 000 dollars. À Davos, le Forum bénéficie d’un statut quasi extraterritorial. Bien que fondation privée, il a signé un accord avec le gouvernement suisse, lui conférant des privilèges et immunités d’ordinaire réservés aux organisations intergouvernementales. Il bénéficie aussi d’un statut d’observateur à l’ONU, lui permettant de participer aux débats avec une légitimité proche de celle d’un État.
Derrière une gouvernance dite « neutre » (il est précisé que « les membres ne représentent aucun intérêt personnel ou professionnel »), on constate que les différents bureaux dirigeants sont composés d’une élite issue des plus grandes institutions financières et technocratiques (le président de la banque mondiale Ajay Banga et Christine Lagarde siègent par exemple au conseil d’administration), ainsi que des membres de gouvernements agissant sans mandat démocratique à l’échelle globale, via des réseaux d’influence transnationaux (FMI, OMS, GIEC, Commission Européenne, fondations privées comme l’Open Society du controversé milliardaire sans-frontieriste George Soros), orientant ainsi les politiques publiques. La liste des « partenaires » paraît infinie.
Mais le FEM développe aussi ses propres programmes d’influence, dont le plus connu, « Young Global Leaders ». Fondé en 2004, il vise à « façonner les futurs leaders mondiaux », dans tous les domaines (ici, la promo 2024 par ex et les anciens). Parmi ses anciens membres figurent Emmanuel Macron, Mark Zuckerberg, Marlène Schiappa, Justin Trudeau, Gabriel Attal, Leonardo Dicaprio… On y compte des cadres de la Commission européenne, mais aussi des figures influentes de la péninsule Arabique, d’Israel, d’Inde … On les retrouve dans des multinationales, fonds d’investissement, start-up, banques centrales, en politique, dans la culture, le sport, ou encore au sein d’ONG. La proximité entre le Forum et le pouvoir chinois interroge aussi. Schwab avait publiquement qualifié la Chine de « modèle » à suivre.
Ils se font régulièrement les promoteurs ou les relais de technologies axées sur l’intelligence artificielle, le transhumanisme, la santé ou encore le contrôle à visée « responsable ». Cette foi en la technosolution n’est pas neutre, c’est un choix idéologique et intéressé. Dans son édition 2017, le FEM mettait notamment en avant les vaccins à ARN messager. Ils ont soutenu la vaccination massive et le pass sanitaire, aujourd’hui largement remis en question (juridiquement, éthiquement et scientifiquement). Ce qui reflète, entre autres, une convergence d’intérêts avec l’industrie pharmaceutique. Mais toute critique est souvent étiquetée de « complotisme » ou « d’extrême droite ». En ce sens, le discours de Javier Milei lors de l’édition 2025 mérite d’être regardé. À noter que l’initiative « Alliance for Responsible Citizenship », portée par Jordan Peterson, incarne l’un des rares contre-forums.
Voici les 10 technologies mises en avant dans l’édition 2025 :
- Des matériaux capables de servir à la fois de structure (carrosserie, fuselage…) et de batterie.
- Des systèmes d’énergie dite « osmotique », c’est-à-dire produisant de l’électricité grâce à la différence de salinité entre eau douce et salée.
- Des réacteurs nucléaires miniatures, supposément plus sûrs. Mais les vieux enjeux demeurent (coût, déchets, dépendance technologique et gouvernance opaque).
- Des thérapies vivantes : des micro-organismes génétiquement modifiés, introduits dans le corps pour le traiter de l’intérieur.
- Des médicaments repositionnés, initialement conçus pour le diabète ou l’obésité ; certains traitements ralentiraient Alzheimer ou Parkinson. Ce n’est pas une nouvelle technologie, mais un usage détourné prometteur.
- Des capteurs biochimiques autonomes, capables d’analyser en continu des données corporelles ou environnementales. Un outil puissant pour la santé et la sécurité ou pour une surveillance permanente.
- Des nanozymes : des nanoparticules qui imitent l’action des enzymes naturelles, pour diagnostiquer ou traiter des maladies.
- Le « watermarking » génératif : il s’agit d’intégrer des marqueurs invisibles dans les contenus produits par IA. Présenté pour lutter contre la désinformation, il ouvre aussi la voie à une censure algorithmique.
- Des engrais « verts » issus de procédés biologiques avancés. Intéressants sur le plan écologique, mais susceptibles d’accroître la dépendance des agriculteurs à des technologies brevetées et à ceux qui les contrôlent.
- Des réseaux de capteurs connectés, capables d’échanger des données en temps réel sur nos déplacements, nos gestes et notre environnement. Utiles pour les secours ou la mobilité. Mais cela installerait une infrastructure de surveillance.
Raphaël Lepilleur pour La Sélection du Jour.


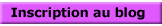
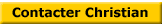
Suivre @ChrisBalboa78

