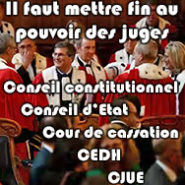
Alors que 70 % des Français veulent contrôler, voire stopper l’immigration, rien n’est fait par les gouvernements.
Quand Macron avait une majorité, rien de se faisait dans ce sens parce qu’il n’en avait pas la volonté politique.
Mais depuis que la Macronie est minoritaire et que la droite participe au gouvernement, les mesures prises pour juguler l’immigration sont bloquées par des juges.
L’Europe nous impose des directives pro-immigration et le Conseil constitutionnel (CC) censure systématiquement toute tentative de contrôle de l’immigration.
La priorité des priorités, pour le futur successeur de Macron à l’Elysée, s’il veut vraiment agir pour le bien des Français, devra être de réformer la Constitution pour redonner le pouvoir au peuple et à ses représentants.
Pour ce faire, il faut trois modifications majeures :
- Redéfinir la hiérarchie des normes de façon à ce que les nouvelles lois françaises puissent s’imposer par rapport aux règles et traités européens,
- Ouvrir le champ du référendum aux besoins réels des Français et notamment au contrôle de l’immigration,
- Réformer le Conseil constitutionnel pour le dépolitiser et en limiter le champ d’action.
Concernant le dernier point je relaye ici un article lumineux publié dans Valeurs actuelles et signé Léonard Zerbib, un avocat constitutionnaliste.
En résumé, il propose trois réformes principales :
- Modifier le mode de nomination des membres pour sélectionner plutôt des juristes que des politiques. Retirer notamment, au chef de l’Etat, la nomination du président du CC pour le faire élire par ses pairs,
- Doter chaque membre du CC d’un pool de juristes pour augmenter la pertinence de leur vote,
- Redéfinir, à la baisse, le champ d’action du CC et le nombre de textes auxquels ils doivent se référer.
Réformer le Conseil constitutionnel est un impératif démocratique
Pour redonner aux politiques leur capacité d’action et éviter une crise de régime, il faut revenir à l’esprit de 1958 de l’institution et notamment modifier l’étendue de sa mission.
Au cours de l’été 2025, le Conseil constitutionnel s’est une fois de plus invité – pour ne pas dire incrusté – dans le débat politique. Parmi les cinq décisions très commentées du 7 août dernier, on retient notamment la censure, très critiquable sur le terrain du droit, de la mesure d’allongement de la durée maximale de rétention administrative des étrangers interdits de territoire et jugés dangereux.
Alors que le Parlement est déjà affaibli par une Assemblée nationale divisée autant que dissipée, ces censures renforcent l’immobilisme politique ambiant en prétendant protéger la Constitution. Réformer cette institution est indispensable pour redonner aux représentants du peuple leur capacité d’action et éviter une crise de régime opposant la légitimité démocratique à celle du juge constitutionnel. Pour cela, trois principaux chantiers doivent être menés.
La première réforme
La première réforme tient au mode de désignation de ses neuf membres, aujourd’hui nommés par le pouvoir politique, sans aucun critère objectif d’expérience ou de compétence, contrairement à ce que prévoit par exemple la Constitution italienne. La perpétuelle suspicion de politisation de l’institution pourrait également être dissipée si son président, dont le rôle est incontournable, était choisi par ses pairs plutôt que par le président de la République.
Le deuxième changement indispensable concerne son fonctionnement interne. L’absence de véritable équipe de juristes affectée à chacun des membres ne leur permet pas de se prononcer en toute indépendance, favorise l’influence décisionnelle du secrétaire général nommé par le président de la République et nuit à la crédibilité de l’institution pour se comporter en juridiction. Nombre de ses décisions sont pauvrement motivées sans crainte d’être contestées, aucune voie de recours n’étant prévue.
Modifier l’étendue de la mission du Conseil constitutionnel
Il faudra ensuite modifier l’étendue de la mission du Conseil constitutionnel. À sa création en 1958, le Conseil constitutionnel ne devait pas être la cour constitutionnelle qu’il prétend être devenu. Ce n’est qu’à partir de 1971 (CC, 16 juillet 1971, no 71-45 DC, liberté d’association) que le Conseil s’est autoattribué le rôle de gardien des droits et libertés en élargissant son contrôle.
En intégrant ainsi dans le bloc constitutionnel des textes très larges, proclamant des droits et libertés, le Conseil constitutionnel s’est octroyé le privilège de les interpréter comme il l’entend, au gré des circonstances politiques et sociales. Ce « coup d’État juridique » de 1971, selon la formule de Robert Badinter, n’a jamais été remis en cause par le pouvoir politique.
C’est au peuple qu’il revient aujourd’hui de trancher cette orientation ! Les Français approuvent-ils la possibilité pour le Conseil constitutionnel de recourir à la Charte de l’environnement de 2004, figurant dans le préambule de la Constitution, pour censurer la réintroduction de l’acétamipride ?
Quelle légitimité le Conseil constitutionnel a-t-il pour consacrer en 2018, au titre de la devise républicaine, que le « principe de fraternité » neutralise le “délit de solidarité” visant à pénaliser les personnes venant en aide aux étrangers en situation irrégulière ?

Cédric Herrou, délinquant condamné pour avoir fait entrer des clandestins, et relaxé par le Conseil constitutionnel au motif que le mot fraternité figure dans la devise de la République française !
Ces débats devront être au cœur de la prochaine élection présidentielle. À défaut, les promesses de campagne seront jugées inaudibles par les Français, persuadés qu’elles seront toujours susceptibles d’être remises en cause par le “gouvernement des juges”. Plus que jamais, réformer le Conseil constitutionnel est un impératif démocratique !
Léonard Zerbib pour Valeurs actuelles.
* Léonard Zerbib est avocat, constitutionnaliste et chargé d’enseignement en droit constitutionnel à l’université Paris-I Panthéon-Sorbonne.


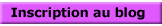
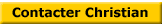
Suivre @ChrisBalboa78


