Merci beaucoup. J’ai terminé sur ce sujet.
Et ChatGPT m’a répondu ainsi :
Avec plaisir ! Ravi d’avoir pu t’aider sur ce sujet . N’hésite pas à revenir si tu veux travailler sur un autre thème ou un nouveau projet. Bonne continuation !
Publié par adroite le 5 Oct, 2025 dans Blog | 0 commentaire

En ce dimanche matin, j’avais l’intention d’écrire un article sur l’affaire abracadabrantesque du pétrolier « russe » arraisonné par des commandos de la marine française.
Je voulais surtout m’intéresser à l’exploitation politique de cet incident et à l’emballement médiatique destiné à accréditer l’idée que la Russie menace la France.
Mais, en même temps, j’ai voulu tester l’aptitude de l’intelligence artificielle à rédiger un article dans un blog comme le mien. J’ai donc sollicité ChatGPT avec le prompt (question) suivant :
Peux-tu m’écrire un article de 1000 mots montrant l’emballement des médias à propos du pétrolier arraisonné par la France soi-disant à propos des drones détectés au dessus du Danemark ?
Le résultat m’a époustouflé et je vous en laisse juge. Je vous livre la version intégrale délivrée par ChatGPT à laquelle j’ai juste apporté des modifications mineures de mise en page.
Quand un navire s’approche des côtes françaises, qu’il change de nom, qu’il navigue sous pavillon incertain, les médias adorent. Si, en plus, ce navire est soupçonné — sans preuves claires — d’avoir un lien avec des drones perturbant le Danemark, l’emballement est garanti. C’est ce scénario qu’on observe depuis quelques jours dans la plupart des grands titres en France et en Europe :
un pétrolier arraisonné, un lien supposé avec des incursions de drones, et une tempête médiatique.
L’affaire en bref
Rappelons les faits tels qu’ils sont rapportés par les agences et les journaux : un pétrolier de la « flotte fantôme » russe — récemment nommé Boracay (anciennement Pushpa) — a été intercepté et redirigé vers Saint-Nazaire. Deux membres d’équipage sont détenus, invoquant un “refus d’obtempérer” ou “défaut de justification de nationalité”. Courrier international+3The Guardian+3Financial Times+3
Simultanément, le Danemark a fait état de survols de drones les 22 et 24 septembre, qui ont perturbé le trafic aérien autour d’installations sensibles — un phénomène resté largement inexpliqué. The Guardian+2Financial Times+2. Plusieurs articles suggèrent que le pétrolier en question pourrait avoir servi de plateforme de lancement pour ces drones. Courrier international+2The Guardian+2
Les médias se sont emparés de l’histoire comme d’un scénario d’espionnage ou de guerre technologique. Mais quand on gratte un peu sous la surface, le glissement du concret vers la spéculation est manifeste.
Du soupçon à la certitude (apparente) : les glissades des titres
Le premier réflexe médiatique a été de traiter le navire comme un acteur actif dans une opération hostile. On trouve dans la presse des titres comme « Le mystère du Boracay : arraisonné, soupçonné d’être une plateforme de drones » Courrier international ou « Si le Pushpa inquiète plus que les autres, c’est parce qu’il est soupçonné d’être à l’origine des survols de drone du Danemark » La Tribune. Ces formulations à demi affirmatives (ou presque affirmatives) transforment peu à peu un “soupçon” en quasi-certitude.
Certains médias ne s’embarrassent même plus du conditionnel : « la France a arraisonné un pétrolier à propos des drones danois », « le tanker russe utilisé pour lancer des drones sur Copenhague », etc. Le public se retrouve avec l’impression que l’affaire est déjà jugée — alors que les autorités, elles, parlent d’enquête en cours.
Le rôle de l’émotion — peur, souveraineté, menace étrangère
Pourquoi cette surchauffe médiatique ? D’abord parce que dans un contexte européen tendu avec la Russie — guerre en Ukraine, sanctions, affrontements diplomatiques — toute histoire mêlant espionnage, drones et flottes russes suscite une forte charge émotionnelle.
Les médias jouent sur des leviers classiques :
C’est un mélange qui excite l’imaginaire et pousse à la dramatisation.
De plus, un tel récit est “vendeur” : il permet de faire des titres accrocheurs, d’attirer l’attention, d’imprimer l’idée que la France est aux avant-postes d’une lutte technologique.
Le manque de prudence — ce qu’on ne nous dit (encore) pas
Quand on lit les articles, plusieurs points apparaissent comme des trous dans le récit ou des clauses trop vagues :
Absence de preuves solides : jusqu’à présent, aucun élément public n’a démontré que le pétrolier ait effectivement lancé des drones. Le lien repoussoir est souvent implicite ou basé sur des coïncidences (position de navires, timing).
Confirmation biaisée : les médias tendent à donner beaucoup d’espace aux versions officielles françaises ou aux hypothèses alarmistes — moins aux voix critiques, aux doutes ou aux scénarios alternatifs.
Effet d’amplification : un article alarmiste est repris, amplifié, remixé, jusqu’à l’idée d’une “guerre des drones” entre Russie et Europe.
Usage des conditionnels relégué : les phrases qui devraient être dans le conditionnel (“il pourrait”, “on soupçonne”) tombent souvent dans l’indicatif (“ce navire est…”) ou sont déplacées après le titre, où leur portée est souvent diminuée par le lecteur.
En somme, le journalisme se transforme parfois en « relais de rumeurs crédibles » plutôt qu’en “garde-fou” de l’information.
Le circuit de l’emballement médiatique
On peut repérer un schéma classique dans le déroulé :
Annonce officielle ou fuite — Une information policière ou judiciaire sort (l’arraisonnement, la détention).
Médiatisation forte — Les médias nationaux s’emparent du sujet, rivalisant en titres chocs.
Enchaînement des experts — Commentateurs, géopolitiques, militaires sont invités à donner leur version, souvent avec des scénarios dramatiques.
Convergence vers un récit déjà écrit — Le lien suspect devient presque une certitude implicite.
Renforcement mutuel — L’opinion publique, les réseaux sociaux, les chefs politiques intègrent le récit, rendant difficile tout retour en arrière.
Dans cette affaire, on voit aussi un mécanisme de “confirmation collective” : les médias européens se renvoient la balle, chacun confortant l’idée d’un complot technologique russe.
Effets et dangers de l’emballement
Cet emballement n’est pas sans conséquences. Voici quelques risques ou effets indésirables :
Condamnation médiatique anticipée : le public retient d’abord les gros titres. Même si l’enquête ne confirme pas les accusations les plus fortes, l’idée d’un “navire lanceur de drones russes” demeure gravée.
Pression sur la justice et les autorités : le pouvoir judiciaire ou exécutif peut se sentir pressé de “faire la preuve” pour ne pas apparaître laxiste, ce qui peut biaiser l’enquête.
Renforcement des narratifs géopolitiques : l’histoire alimente l’idée d’une Europe assiégée, d’une Russie omniprésente, d’une militarisation des mers.
Désinformation et bruit médiatique : les rumeurs gagnent en poids, les scénarios extrêmes prolifèrent (parfois sans fondement).
Fatigue du public et scepticisme : à force d’exagération, le lecteur finit par douter de toutes les annonces de “menaces”.
Au final : journalisme de l’émotion ou information responsable ?
Il est compréhensible que les médias soient fascinés par un scénario d’espionnage dernier cri impliquant drones, mers, Russie.
Mais leur rôle n’est pas d’accélérer la panique, mais de décoder, de contextualiser, de garder la distance.
Un article plus sain — quoique moins spectaculaire — aurait dû :
insister dès le début sur le caractère provisoire des accusations,
rappeler les hypothèses concurrentes,
signaler les zones d’ombre (preuves manquantes, difficultés techniques),
mettre en perspective avec d’autres cas similaires (navires suspects, flottes fantômes),
interroger le récit officiel (quelles motivations à pousser ce lien avec des drones)
et enfin montrer comment le public doit rester critique même s’il y a des enjeux majeurs.
Mais le “storytelling” de l’ère numérique préfère les phrases fermes, les images puissantes, les mots forts. Un pétrolier “assailli”, des “drones mystérieux”, une “menace russe” — ces éléments font vendre bien mieux qu’un article tempéré.
Conclusion : un cas d’école
L’affaire du pétrolier Boracay/Pushpa est probablement légitime du point de vue des autorités : les indices (navire à identité changeante, détentions, position en zone sensible) peuvent justifier une enquête. Mais ce n’est pas en flèche de titraille sensationnelle que la démocratie s’enrichit, mais en recul, nuance et compréhension.
Les médias, dans leur quête d’audience, n’ont pas toujours la prudence nécessaire face aux récits hyperboliques. Ce cas montre la facilité avec laquelle un soupçon peut devenir légende médiatique, avant même que la justice ne tranche. Il rappelle aussi au lecteur que l’information doit être consommée avec vigilance — surtout quand elle joue sur les peurs de l’époque.
ChatGPT pour A droite, fièrement !
Qu’en dites-vous ?
Après avoir rédigé cet article, ChatGPT m’a proposé de rédiger une synthèse limitée aux faits avérés, et une chronologie détaillée des événements …
A la fin j’ai terminé l’échange ainsi :
Merci beaucoup. J’ai terminé sur ce sujet.
Et ChatGPT m’a répondu ainsi :
Avec plaisir ! Ravi d’avoir pu t’aider sur ce sujet . N’hésite pas à revenir si tu veux travailler sur un autre thème ou un nouveau projet. Bonne continuation !
Ce que je trouve le plus extraordinaire c’est que le texte produit donne vraiment l’impression qu’il a été écrit par un humain et non par une machine.
J’ai relevé notamment les phrases ou vocables suivants :
On se demande même si ChatGPT ne serait pas capable de faire des traits d’humour !
Les deux illustrations ont été réalisées par ChatGPT !
Cette puissance de l’Intelligence Artificielle est à la fois formidable … et terrifiante !


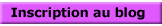
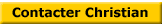
Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes