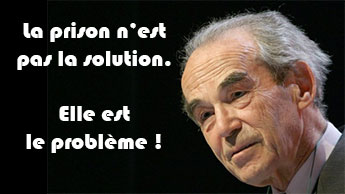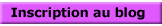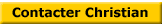Alors que la faillite de la Justice est aujourd’hui patent et qu’elle est accusée de laxisme par une grande majorité de Français, et par tous les policiers, Macron s’apprête à faire entrer au Panthéon le grand ordonnateur de l’idéologie de l’inversion victimaire : Robert Badinter !
Que fera t-il aux côtés de Jean Moulin, d’Emile Zola, d’Alexandre Dumas et de Victor Hugo ?
La plupart des Gardes des sceaux de gauche se sont inscrits dans ce mouvement de victimisation des délinquants et de mépris pour les victimes.
Des ministres de la justice comme Christiane Taubira, Nicole Belloubet et Eric Dupont-Moretti, tous guidés par la fameuse harangue de Baudot, auront tout fait pour appliquer la fameuse théorie gauchiste :
La prison n’est pas la solution. Elle est le problème !
Robert Badinter est connu comme le Garde des sceaux qui a imposé au peuple français, contre sa volonté, l’abolition de la peine de mort.
Si, à titre personnel, j’approuve cette abolition, je trouve indigne qu’on l’ait imposée aux Français, contre leur gré. Par ailleurs, la promesse de remplacer la peine de mort par une peine de perpétuité réelle a bien sûr été oubliée par la gauche !
Outre l’abolition de la peine capitale, Robert Badinter a également fait prendre à la Justice le virage de la victimisation des délinquants et des criminels que les Français payent aujourd’hui.
Voici un article de Polemia qui rappelle les responsabilité de Robert Badinter dans la faillite actuelle de la Justice :
Robert Badinter, le grand architecte de la fragilité judiciaire

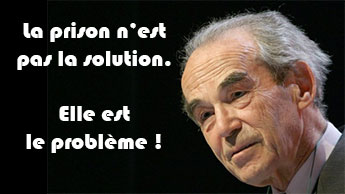
L’entrée au Panthéon de Robert Badinter est prévue le 9 octobre prochain, date anniversaire de la promulgation de la loi d’abolition de la peine de mort a été voulue par Emmanuel Macron. Pour Jean-Yves Le Gallou et l’équipe de Polémia, c’est une décision incompréhensible, tant la politique de Robert Badinter fut nocive pour la France. D’ici le 9 octobre, Polémia vous proposera de nombreux articles montrant à quel point Robert Badinter a fait du mal à notre pays, rendant impensable sa panthéonisation. Dans l’article ci-dessous, notre équipe réalise une synthèse de ses méfaits. Car si Robert Badinter a marqué son époque – pour l’abolition de la peine de mort, ses réformes judiciaires et sa lutte contre le racisme –, ses engagements, guidés par un humanisme revendiqué, n’en demeurent pas moins sujets à caution aujourd’hui alors que de plus en plus de voix s’élèvent contre le laxisme judiciaire et l’érosion incessante de la liberté d’expression.
L’abolition de la peine de mort : un tournant « humaniste » aux effets débattus
Robert Badinter (1928-2024) est une figure majeure du droit et de la politique française ; adoubé par la gauche et une écrasante majorité de la droite pour son rôle dans l’abolition de la peine de mort, il est également à l’origine de la réforme du système judiciaire. Son combat contre le racisme et l’antisémitisme l’auréole par ailleurs des vertus morales ultimes dans la France de ce début de XXIe siècle. Son rôle dans l’affaire du sang contaminé est aujourd’hui complètement sorti des radars tandis que la « dépénalisation de l’homosexualité » lui est attribuée à tort.
Cependant, l’état de délabrement de l’appareil judiciaire français, le laxisme des tribunaux à l’endroit des délinquants mais aussi la mise en pièces de la liberté d’expression peuvent donner à envisager autrement le bilan des combats menés par l’ancien avocat et militant socialiste.
Le combat de Robert Badinter contre la peine de mort est l’un des plus emblématiques de sa carrière. En tant qu’avocat, puis ministre de la Justice sous François Mitterrand, il a porté cette cause avec une détermination sans faille, aboutissant à l’abolition en France en 1981. Son engagement prend racine dans une expérience personnelle marquante : l’exécution de son client Roger Bontems en 1972, guillotiné pour complicité dans une prise d’otages à Clairvaux, bien qu’il n’ait pas directement tué. Dans son ouvrage L’Exécution (1973), Badinter décrit cette expérience, qui forge sa conviction que la peine capitale est inhumaine et inefficace. En 1977, sa plaidoirie dans l’affaire Patrick Henry, accusé du meurtre d’un enfant, illustre son approche. Sans nier la culpabilité de son client, il dénonce ce qu’il considère comme la barbarie de la peine de mort et convainc le jury de prononcer la réclusion à perpétuité plutôt que l’exécution, défiant une opinion publique hostile.
En 1981, nommé garde des Sceaux au début de la présidence de François Mitterrand, il prononce un discours historique le 17 septembre devant l’Assemblée nationale. Pendant près de deux heures, il mêle arguments moraux, juridiques et historiques, déclarant :
Demain, grâce à vous, la justice française ne sera plus une justice qui tue.
La loi est adoptée (363 voix contre 117 à l’Assemblée, 160 contre 126 au Sénat) et promulguée le 9 octobre 1981, faisant de la France le 35e pays abolitionniste. Aujourd’hui béatifié par le République, il est cependant contesté, au-delà des arguments d’ordre philosophique, par des études de type scientifique. C’est le cas notamment d’études économétriques américaines évoquées par Polémia en 2021, comme celle de Paul R. Zimmerman (2004), estimant qu’une exécution prévient 14 meurtres. Pour les partisans de la peine capitale, l’abolition sacrifie des vies innocentes au nom d’un idéal humaniste. Ils soulignent que la réclusion à perpétuité, présentée comme une alternative, est souvent écourtée par des remises de peine, rendant la justice moins intimidante pour les criminels.
Quant à l’argument de l’erreur judiciaire, avancé par Badinter, il s’agit de rappeler qu’aucune exécution aux États-Unis n’a été reconnue officiellement par les autorités politiques et que les procédures et les recours sont nombreux avant d’en arriver à la peine capitale.
Signez la pétition contre l’entrée de Robert Badinter au Panthéon :
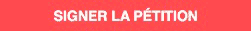
Réformer la justice : entre humanitarisme et accusations de laxisme
Robert Badinter ne s’est pas contenté d’abolir la peine de mort. En tant que ministre de la Justice (1981-1986), il a entrepris des réformes visant à transformer le système judiciaire, arguant vouloir le rendre plus équitable et humain. Il supprime ainsi les juridictions d’exception, comme la Cour de Sûreté de l’État et les tribunaux militaires, jugées contraires à « l’État de droit », une notion revenue en force pour contourner l’opinion majoritaire depuis quelques années. En 1985, il introduit une loi sur l’indemnisation des victimes d’accidents de la route, renforçant leurs droits spécifiques. Il promeut également l’accès à l’aide judiciaire pour les plus démunis et, plus tard, en tant que sénateur (1995-2011), dénonce les conditions qu’il considère comme inhumaines dans les prisons françaises surpeuplées, à l’unisson avec la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) qui se fera l’écho de mêmes critiques notamment en 2020 et 2023.
Pourtant, ces réformes au vernis humanisant sont accusées d’avoir encouragé un laxisme judiciaire et favorisé une approche favorable au coupable au détriment des victimes.
Au cœur de la transformation idéologique des années 1968, Robert Badinter a favorisé l’émergence d’une « culture de l’excuse ». Cette vision, incarnée par le Syndicat de la magistrature et sa « harangue de Baudot » (1975) (sa charte), prône une justice partiale, favorisant le délinquant au détriment de la victime.
Les peines maximales sont ainsi très rarement appliquées en France, les condamnations pour violences contre des agents publics représentent souvent 1/6ème des peines prévues, et seulement 60 % des cas entraînent une incarcération. Entre 2009 et 2019, les homicides ont augmenté de 79 %, et les coups et blessures de 27 %, des chiffres qui illustrent concrètement l’échec de l’esprit des réformes de Badinter à endiguer la criminalité.
Au-delà de cet échec, s’est véritablement mis en place un « laxisme sélectif ». Si la justice a sévèrement réprimé les Gilets jaunes (10 000 gardes à vue, 3 200 condamnations), elle semble plus indulgente envers les émeutiers ethniques de 2023 (600 incarcérations pour 100 000 à 200 000 participants). Cette disparité alimente l’idée d’une justice idéologiquement biaisée, influencée par l’humanisme de Badinter, qui privilégierait certains justiciables au détriment de la sécurité publique.
La lutte contre le racisme et l’antisémitisme : la boite de Pandore de Badinter
Marqué par la Seconde Guerre mondiale, son père, Simon Badinter, mort à Sobibor en 1943, Robert Badinter a fait de la lutte contre le racisme et l’antisémitisme un pilier de son engagement.
En 1980, en tant qu’avocat de la LICRA, il obtient la condamnation Robert Faurisson, pour diffamation raciale, en raison de ses propos sur l’histoire de la seconde guerre mondiale. En 1979, il signe une tribune dans Le Monde plaidant pour l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité, s’opposant à la prescription pour des criminels nazis comme Jean Leguay. C’est ici une acrobatie idéologique notable. Aucune prescription n’est ainsi possible si l’on touche à d’anciens criminels politiques en revanche les criminels contemporains pourront jouir d’une étonnante clémence.
Les lois antiracistes, soutenues par Badinter, favorisent aujourd’hui une justice à deux vitesses : des propos comme ceux du rappeur Nick Conrad, incitant à la violence contre les Blancs, semblent échapper à la répression, tandis que les discours critiques de l’immigration ou de l’islam sont sévèrement sanctionnés.
Le scandale du sang contaminé : responsabilités politiques et failles systémiques
Au milieu des années 1980, la France a connu le scandale du sang contaminé, avec des milliers de personnes transfusées ou hémophiles infectées par le VIH ou l’hépatite C. En 1999, la Cour de justice de la République a relaxé Laurent Fabius, tandis qu’Edmond Hervé a été condamné avec dispense de peine ; la formule « responsable mais pas coupable » restera attachée à cette crise, prononcée en 1991 par l’ancienne ministre Georgina Dufoix. Les associations d’hémophiles estiment qu’environ 1 350 hémophiles ont été contaminés et près d’un millier sont décédés.
Un fait lourd : des collectes de sang en prison ont été maintenues et même accru leur fréquence au début de 1984 par circulaire de l’administration pénitentiaire, relevant alors du ministère de la Justice dirigé par Robert Badinter ; un rapport interministériel rendu public en 1992 conclura que ces collectes ont été « à l’origine de plusieurs centaines de cas de contamination ».
Dépénalisation de l’homosexualité : égalisation à 15 ans, quand le mythe est un mensonge
Sous l’impulsion du gouvernement Mauroy, la loi du 4 août 1982 abroge l’alinéa 2 de l’article 331 du Code pénal qui instaurait un régime d’âge de majorité sexuelle pour les relations homosexuelles. Robert Badinter, garde des Sceaux, plaide à l’Assemblée pour l’égalité de traitement à 15 ans, âge déjà en vigueur pour l’hétérosexualité (depuis 1945, puis 1974). Il sera souvent avancé l’idée selon laquelle Badinter a « dépénalisé » l’homosexualité ce qui est faux, celle-ci était déjà dépénalisée avec le code pénal de 1791 sous la monarchie constitutionnelle.
Par la suite, il défendra l’idée d’une dépénalisation universelle de l’homosexualité.
Un des pères fondateurs (sans le savoir ?) de l’anarcho-tyrannie
L’œuvre de Robert Badinter aura été l’une des pierres centrale de l’édifice anarcho-tyrannique dans lequel vivent aujourd’hui les Français.
L’État réprime durement les citoyens respectueux des lois tout en tolérant la délinquance dans certaines zones ou communautés. Badinter, en promouvant une justice revendiquée comme humaniste a été un des pères fondateurs de ce système. Sa défense de la dépénalisation des relations homosexuelles avec des mineurs de plus de 15 ans en 1982, présentée comme une avancée égalitaire, a participé à une forme de complaisance avec la pédocriminalité.
Son rôle au Conseil constitutionnel (1986-1995) est aussi à prendre en compte. Il y a bloqué des mesures restrictives sur l’immigration, posant les bases d’un « droit à l’immigration » pour les clandestins, au détriment de la sécurité des Français.
Le chaos judiciaire comme héritage
Robert Badinter a transformé la justice française par son intransigeance humaniste revendiquée. Son abolition de la peine de mort, contre une opinion publique réticente, est un coup d’État élitaire contre le peuple au nom d’une certaine morale. L’abolition de la peine de mort comme peine ultime aura considérablement affaibli l’institution judiciaire, rétrécissant sans cesse l’échelle des peines.
Ses réformes judiciaires ont renforcé les droits des délinquants, des criminels et des détenus au détriment des victimes. En privilégiant la réinsertion et les droits des délinquants, et en alimentant un laxisme sélectif, où la justice réprime durement certains (Gilets jaunes, citoyens autochtones, historiens contestataires) tout en tolérant d’autres (émeutiers, immigrés, délinquants récidivistes), il aura participé à une entreprise plus large d’imposition d’une repentance et d’un véritable catéchisme de culpabilité pour les Français.
Sa lutte contre le racisme et l’antisémitisme, nourrie par les évènements de la Seconde Guerre mondiale, a, elle, jeté les bases de lois liberticides réduisant le champ du débat libre.
L’entrée de Robert Badinter au Panthéon en octobre 2025, semble être l’apogée (avant le déclin ?) d’une icône qui sous couvert d’humanisme aura bridé l’institution judiciaire, porté des coups redoutables à la liberté d’expression et incarné finalement l’archétype de l’élite déconnectée des aspirations populaires.
Polémia
14/09/2025
Sources :
L’Exécution. Robert Badinter Paris : Grasset, 1973.
L’Abolition. Robert Badinter Paris : Fayard, 2000.
https://www.amnesty.fr/peine-de-mort-et-torture/actualites/17-septembre-1981-discours-de-robert-badinter
https://jeunes.amnesty.be/IMG/pdf/202309_dossier_pe_dagogique_pdm_actualise__def.pdf
https://www.philomag.com/articles/peine-de-mort-la-grande-divergence-franco-americaine
https://www.polemia.com/zemmour-sur-la-peine-de-mort-une-rupture-necessaire-avec-lideologie-dominante/
https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2024/02/09/robert-badinter-est-mort_6215627_3382.html
https://www.lemonde.fr/archives/article/1992/04/11/contamination-le-sang-des-prisons-la-forte-proportion-de-personnes-infectees-en-france-par-le-virus-du-sida-a-la-suite-d-une-transfusion-s-explique-en-partie-par-les-collectes-effe_3907555_1819218.html