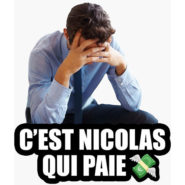
François Bayrou n’a rien compris !
Si le premier ministre croit qu’il va, encore une fois, ponctionner ceux qui se lèvent tôt, et ceux qui se sont levés tôt pendant des décennies, il se trompe grave !
La majorité laborieuse et entrepreneuriale a pris conscience du fait qu’en France, l’assistanat s’est beaucoup trop développé et la spolie.
Depuis quelques années, on a assisté à la montée du rejet de l’immigration avec deux tiers des Français qui veulent qu’on la stoppe. Ils ont conscience que l’immigration est responsable d’une véritable saignée dans les forces vives de la nation.
Le consentement à PLUS d’impôts est mort !
On a vu récemment des mouvements se créer quasi spontanément pour crier ce ras-le-bol fiscal. C’est le cas des Gueux d’Alexandre Jardin qui se bat contre l’explosion du coût de l’électricité et du mouvement C’est Nicolas qui paie qui conteste les dépenses de l’Etat.
Voici un article de fond sur ce dernier mouvement publié par The Epoch Times :
« C’est Nicolas qui paie » :
le cri d’une génération sacrifiée
sur l’autel d’un modèle social défaillant
Depuis l’été 2025, une expression revient sur les réseaux sociaux français : « C’est Nicolas qui paie ». Ce slogan ironique est devenu l’étendard d’un mouvement social inédit, porté par une génération de jeunes actifs exaspérés par une fiscalité qu’ils jugent écrasante et une redistribution perçue comme inéquitable.
Ce ras-le-bol fiscal s’inscrit dans une longue tradition de révoltes contre l’impôt en France, tout en se distinguant par son caractère spontané, décentralisé et utilisant les réseaux sociaux pour se propager.
Un mème* devenu cri de ralliement
Le mouvement « C’est Nicolas qui paie » tire son nom d’un mème viral popularisé sur les réseaux sociaux vers la fin de l’année 2024. « Nicolas », personnage fictif, incarne le contribuable français type : un homme ou une femme d’environ 30 ans, actif, souvent diplômé, qui travaille dur mais se sent asphyxié par les impôts et les cotisations sociales.
Ce mème dénonce avec une ironie l’idée que tout semble « gratuit » dans le modèle social français, mais que c’est toujours « Nicolas » qui en assume le coût. Le mouvement s’est rapidement propagé au-delà des réseaux sociaux, avec des hashtags comme #JeSuisNicolas ou #NicolasQuiPaie, et même une déclinaison féminine, @JulieQuiPaie, symbolisant l’épouse fictive de Nicolas.
Derrière l’humour et la dérision des mèmes, le message est clair :
les « Nicolas » en ont assez de financer un système qu’ils estiment inefficace, opaque et injuste.
La tradition française de la révolte fiscale
La révolte des « Nicolas » s’inscrit dans une longue histoire de contestations fiscales en France. Sous l’Ancien Régime, les soulèvements contre la taille ou la gabelle étaient fréquents, portés par des paysans écrasés par des taxes jugées insupportables.
Aujourd’hui, bien que le contexte ait changé, le sentiment d’injustice fiscale reste similaire. Avec un taux de prélèvements obligatoires de 44,8 % du PIB en 2023, la France se distingue comme le champion européen de la fiscalité, loin devant la moyenne de la zone euro (39,2 %).
Cependant, ce mouvement se distingue des révoltes passées par son ancrage dans l’ère numérique. Contrairement aux jacqueries de l’Ancien Régime ou même aux Gilets jaunes de 2018, « C’est Nicolas qui paie » est avant tout une révolte silencieuse, qui s’exprime à travers des publications virales. Cette dimension numérique confère au mouvement une portée inédite, lui permettant de toucher des centaines de milliers de personnes en quelques clics.
Le visage d’une France qui travaille pour pas grand chose
« Nicolas » est certes une figure allégorique mais terriblement concrète pour ceux qui s’y reconnaissent. Il représente la classe moyenne active, celle qui se lève tôt, travaille dur, et paie ses impôts sans bénéficier proportionnellement des services publics. C’est le cadre qui cotise toute l’année pour la santé et la sécurité sociale mais qui peine à trouver un médecin quand il en a besoin, c’est l’artisan asphyxié par les charges, ou encore la retraitée modeste dont la pension est rognée par l’inflation.
Le mouvement met en lumière un sentiment de « déclassement » chez les jeunes générations, particulièrement les trentenaires. Malgré un niveau d’études élevé, ces derniers font face à un pouvoir d’achat stagnant, une crise du logement aiguë et une promesse d’ascenseur social brisée. Comme le souligne Le Figaro, le contrat social semble rompu : les « Nicolas » ont l’impression de « payer pour tout sans rien recevoir en retour ».
Ce ras-le-bol s’articule autour de plusieurs cibles précises :
- le système de retraites par répartition, jugé inéquitable face à une démographie déclinante (1,7 actif par retraité contre 3,3 en 1970) ;
- le gaspillage de l’argent public ;
- ou encore le coût de l’immigration avec les 1,2 milliard d’euros alloués à l’Aide Médicale d’État (AME) en 2023.
Ces griefs cristallisent une colère profonde contre un État perçu comme inefficace et dispendieux.
Une synthèse idéologique : libéralisme, minarchisme et controverses
Sur le plan idéologique, « C’est Nicolas qui paie » est difficile à enfermer dans une seule catégorie. Selon Luc Gras, interrogé par Atlantico, le mouvement s’inscrit dans une mouvance libérale, avec des accents libertariens, prônant une réduction drastique de l’intervention de l’État hors des fonctions régaliennes (police, justice, armée).
Certains promoteurs du mouvement, comme le créateur de @NicolasQuiPaie, se revendiquent proches du « minarchisme identitaire », une idéologie qui aspire à un État minimal tout en mettant l’accent sur une identité nationale forte.
Cependant, cette synthèse idéologique n’est pas sans ambiguïté. Si le mouvement séduit par son discours anti-fiscal et anti-bureaucratique, il est parfois accusé de véhiculer des représentations xénophobes, notamment à travers des mèmes opposant « Nicolas » à des personnages comme « Karim », stéréotype du bénéficiaire d’aides sociales.
Des médias comme Franceinfo ont pointé du doigt ces représentations, associant le mouvement à l’extrême droite. Ces accusations, bien que fondées sur des dérives réelles, méritent d’être nuancées. Les animateurs du mouvement insistent sur son caractère décentralisé et rejettent toute affiliation à l’extrême droite, se présentant comme une « communauté » de contribuables frustrés.
Sébastien Caré, spécialiste du libertarianisme, note qu’il s’agit davantage d’une convergence entre des droites libérales et identitaires que d’un agenda raciste systématique. Pour autant, le mouvement gagnerait à mieux se distancier des publications controversées pour clarifier son message.
Note du blogueur : je conteste cette dernière phrase notamment le vocable « publications controversées ». Controversées par qui ? Par les Français ou par la gauche bien-pensante ? On doit pouvoir évoquer le thème du coût de l’immigration sans être automatiquement classé à l’extrême droite !
Un succès fulgurant mais pas de structure politique
Le succès de « C’est Nicolas qui paie » est indéniable. En Rhône-Alpes, par exemple, des groupes locaux se sont structurés autour de Lyon, Grenoble et Annecy, réunissant des milliers de membres. Une enquête d’OpinionRhône indique que 28 % des actifs de 25 à 45 ans dans la région se reconnaissent dans les idées du mouvement.
Ce succès s’explique par un contexte économique tendu : une croissance en berne (0,9 % prévue en 2025), un chômage structurel de 7,4 %, et une dette publique flirtant avec les 115 % du PIB. Dans ce climat, le discours des « Nicolas » trouve un écho auprès des entrepreneurs, artisans et cadres qui se sentent pénalisés par une fiscalité lourde et un retour sur investissement jugé insuffisant.
Pourtant, le mouvement fait face à plusieurs défis. D’abord, son caractère spontané et décentralisé, bien qu’il soit une force sur les réseaux sociaux, limite sa capacité à se structurer en une force politique cohérente. Comme le note Luc Gras, des initiatives libérales similaires, comme celle d’Alain Madelin, ont toujours rencontré une forte résistance dans un pays historiquement attaché à l’interventionnisme de l’État. Ensuite, les accusations de racisme et d’affiliation à l’extrême droite risquent de polariser le débat, de le détourner de son axe initial ou d’aliéner une partie de ses sympathisants potentiels.
Note du blogueur : même remarque que précédemment ! Vouloir réduire des dépenses sociales sans parler d’immigration n’a aucun sens !
Vers une influence politique durable ?
Le mouvement est cependant à un tournant. Comme le rapporte Europe 1, il commence à se structurer, comme le site https://cestnicoquipaye.fr/ qui souhaite voir les idées des « Nicolas » reprises par les décideurs politiques sans pour autant créer un parti. Des affiches, stickers et flyers sont en préparation, et certains évoquent des actions dans la rue, à l’image des Gilets jaunes.
Avec les élections municipales et régionales de 2026 en ligne de mire, les idées du mouvement – réduction des impôts, simplification administrative, critique des dépenses publiques – pourraient être reprises par des candidats de la droite libérale ou populiste.
Cependant, le mouvement devra surmonter plusieurs écueils pour transformer son ras-le-bol en projet politique. La France, historiquement attachée à son modèle social, reste réfractaire à des réformes ultralibérales. Les Gilets jaunes, bien que soutenus par une large majorité à leur apogée, n’ont pas réussi à se structurer en force politique durable.
De plus, la question de la redistribution et de la solidarité nationale reste un point de friction : si les « Nicolas » dénoncent un système à bout de souffle, d’autres rappellent que les impôts financent des services essentiels, comme les hôpitaux ou l’éducation, dont ils bénéficient également.
Une révolte symptomatique d’un malaise profond
Le mouvement « C’est Nicolas qui paie » est le symptôme du malaise d’une génération qui se sent sacrifiée sur l’autel d’un modèle social en crise. Comme le souligne l’économiste Erwann Tison, ce ras-le-bol est « un mouvement de fond », les prémices d’une révolte fiscale qui pourrait bouleverser le débat public.
Ce mouvement met en lumière des contradictions françaises : un État-providence généreux mais coûteux, une fiscalité lourde mais mal acceptée, et une défiance croissante envers les institutions. Il pose aussi la question de la légitimité de l’impôt dans une société où la transparence et l’efficacité des dépenses publiques sont mises en doute. Pour répondre à la colère des « Nicolas », l’État devra réformer la fiscalité, rationaliser les dépenses et restaurer la confiance, sous peine de voir ce mouvement s’amplifier, voire se radicaliser.
« C’est Nicolas qui paie » est le cri d’une France laborieuse qui ne veut plus être la vache à lait d’un système perçu comme à la dérive. À l’heure où la France fait face à des défis économiques et sociaux majeurs, « Nicolas » incarne la révolte fiscale et morale d’un pays qui cherche une nouvelle direction.
Reste à savoir si l’État saura entendre ce cri du contribuable ou, comme le laissent présager les dernières déclarations du Premier ministre sur les jours fériés, continuera à faire peser sur lui un modèle social défaillant.
Gaspard Lienard pour The Epoch Times.
* Mème : Concept (texte, image, vidéo) massivement repris, décliné et détourné sur Internet de manière souvent parodique, qui se répand très vite, créant ainsi le buzz.


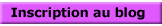
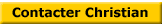
Suivre @ChrisBalboa78

