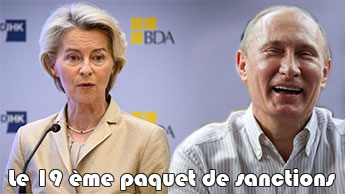Ces célèbres paroles de Bruno Le Maire, alors ministre de l’économie, font encore rire dans les rue de Moscou !
Mais vous, Français, ne riez pas trop car si, dans le titre de cet article, vous remplacez « russe » par « française », vous voyez que Bruno Le Maire a bien réussi son coup !
Il n’y a pas qu’à Paris qu’on prend sa vessie pour une lanterne ! A Bruxelles aussi, l’Europe affabule !
Macron nous vend à l’envi « l’Europe puissance » !
Mais que penser d’une puissance dont la présidente annonce, sans rire, qu’elle prépare un 19 ème paquet de sanctions contre la Russie ? Reconnaissant ainsi l’échec des 18 précédents !
Voici un article du Saker francophone qui se gausse des tartarinades de l’Europe :
L’insensé régime de sanctions de l’Europe
dont Moscou et Pékin n’ont que faire
« Il est temps de fermer le robinet« , a annoncé la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen la semaine dernière, dans sa 19e tentative de faire pression sur la Russie. Le dernier train de sanctions proposé comprend une interdiction des importations de gaz naturel liquéfié (GNL) russe à partir de janvier 2027 — un an plus tôt que prévu — et étend les sanctions aux raffineries et aux négociants en pétrole de pays tiers, tels que la Chine et l’Inde, accusés d’aider la Russie à contourner les sanctions.
Sur le papier, cela est présenté comme une étape décisive pour « réduire les revenus de guerre de la Russie » et forcer Moscou à s’asseoir à la table des négociations. En pratique, ce n’est guère plus que la continuation d’une politique qui a échoué à maintes reprises. La Russie n’a pas été mise à genoux et a redirigé les flux d’énergie ailleurs, tandis que l’Europe a été paralysée par la hausse des prix et s’est enfermée dans une position de dépendance permanente vis-à-vis des États-Unis.
Avant l’invasion de l’Ukraine en 2022, la Russie était le plus grand fournisseur de pétrole et de gaz naturel de l’UE. Depuis lors, la part de la Russie dans les importations de pétrole de l’UE est passée de 29% à 2% et celle du gaz de 48% à 12%. Pourtant, les importations n’ont pas complètement cessé. Deux pipelines restent opérationnels : le pipeline Druzhba, qui achemine toujours du pétrole vers la Hongrie et la Slovaquie, et le pipeline TurkStream, qui fournit du gaz à la Bulgarie, à la Hongrie, à la Grèce et à la Roumanie. Pendant ce temps, l’UE s’est empressée de remplacer le gazoduc russe par du GNL beaucoup plus cher et dont le prix est volatil, et dont la part des importations totales de gaz de l’UE a plus que doublé, passant de 20% à 50%. Près de la moitié de ce GNL provient désormais des États-Unis, ce qui fait de l’Europe le marché le plus important pour les exportations américaines de GNL.
L’ironie est que, alors que l’UE se vantait de réduire les importations par pipeline en provenance de Russie, elle a discrètement augmenté ses achats de GNL russe, dont la majeure partie est destinée à la France, à l’Espagne, aux Pays-Bas, à la Belgique et à l’Italie. Il s’agit simplement d’une question de réalité économique : non seulement le GNL russe est “nettement moins cher” que le gaz liquéfié américain, mais les accords existants lient les acheteurs européens aux approvisionnements russes.
Rien, cependant, n’illustre mieux l’absurdité du régime de sanctions de l’UE que le fait que l’Europe continue d’importer indirectement de grandes quantités de pétrole russe. Au lieu d’acheter du brut bon marché directement de Russie, comme c’était le cas auparavant, elle achète maintenant des produits raffinés à des pays comme l’Inde et la Turquie, qui importent du brut russe, le raffinent et le revendent à l’Europe à un taux de marge significatif. Rien qu’au cours des six premiers mois de 2025, l’UE et la Turquie ont importé 2,4 millions de tonnes de produits pétroliers venant d’Inde. Les estimations suggèrent que les deux tiers de cette production provenaient du brut russe. En effet, l’UE et la Turquie ont payé à l’Inde environ 1,5 milliard d’euros pour un pétrole qui était russe sauf de nom.
Cela signifie que l’Europe paie maintenant plus cher pour le même pétrole russe qu’auparavant, tout en payant plus cher pour le GNL qui remplace celui qui venait par le gazoduc russe. Le bloc s’est ainsi tiré une balle dans le pied à deux reprises : une fois en remplaçant le gaz russe bon marché par du GNL américain (et russe) plus cher, et à nouveau en remplaçant les importations directes de pétrole russe par des achats indirects et plus coûteux en Inde et en Turquie.
Les conséquences ont été brutales. L’Europe a connu trois années consécutives de stagnation industrielle. L’Allemagne – autrefois le moteur du continent – connaît actuellement une désindustrialisation pure et simple, avec 125 000 emplois industriels perdus au cours des dernières semaines seulement.
La Russie, quant à elle, est sortie relativement indemne, réorientant ses exportations vers l’Asie et consolidant son partenariat avec la Chine. Du point de vue des intérêts à long terme de l’Europe, la voie évidente serait de normaliser à nouveau les relations économiques avec Moscou, de reprendre les importations d’énergie bon marché et de travailler à une fin négociée de la guerre. Mais la rationalité a depuis longtemps disparu de la politique européenne. En effet, Bruxelles a doublé la mise, annonçant non seulement l’interdiction du GNL, mais également une interdiction de facto de toute utilisation future des pipelines Nord Stream, tout en sabotant tout effort de paix.
La justification, encore une fois, est que les sanctions forceront la Russie à mettre fin à la guerre aux conditions de l’Occident. La réalité est que 18 paquets de sanctions n’ont pas réussi à atteindre cet objectif, et le 19 ème ne fera pas mieux. Ce que cela fera, cependant, c’est approfondir la dépendance de l’Europe vis-à-vis des États-Unis.
En effet, le calendrier du nouveau train de sanctions n’était pas une coïncidence. Quelques jours plus tôt, Donald Trump avait lancé un ultimatum aux alliés de l’Otan. Les États-Unis, a-t-il déclaré, n’imposeraient de nouvelles sanctions “majeures” à la Russie qu’une fois que les Européens auraient accepté de cesser d’acheter du pétrole russe. Il est allé plus loin, suggérant à l’Otan d’imposer des droits de douane de 50 à 100% à la Chine et à l’Inde, qu’il accuse toutes deux de contourner les sanctions. Il a insisté sur le fait que de telles mesures affaibliraient le “fort contrôle” de la Russie sur ses partenaires. Trump a même affirmé que l’arrêt des importations d’énergie russes, combiné à de lourds tarifs douaniers sur la Chine, serait “d’une grande aide” pour mettre fin au conflit.
La logique est déconcertante. L’Europe n’a aucun pouvoir pour forcer la Chine ou l’Inde à cesser d’acheter du pétrole russe. Les droits de douane sur ces pays alimenteraient une inflation exorbitante et déclencheraient des contre-droits qui dévasteraient les exportateurs européens. Même les diplomates de l’UE reconnaissent en privé que les conditions de Trump sont irréalistes — comme Trump lui-même ne le comprend probablement que trop bien. Pourtant, ses demandes révèlent l’essence transactionnelle de la politique transatlantique aujourd’hui.
L’ultimatum de Trump s’inscrit dans une stratégie américaine plus large : dominer le marché européen de l’énergie. Le secrétaire américain à l’Énergie, Chris Wright, l’a expliqué explicitement : “Vous voulez avoir des fournisseurs d’énergie sûrs qui sont vos alliés, pas vos ennemis. » Selon le plan de Washington, les États-Unis pourraient représenter près des trois quarts des importations européennes de GNL d’ici quelques années. En effet, ExxonMobil s’attend maintenant à ce que l’Europe signe des contratspluriannuels de gaz américain dans le cadre de sa promesse d’acheter 750 milliards de dollars d’énergie américaine.
Jusqu’à récemment, les pays de l’UE résistaient à de tels accords, craignant une dépendance aux combustibles fossiles et une atteinte aux objectifs climatiques. Mais la marée a changé. L’Italien Eni a récemment signé un accord de 20 ans avec Venture Global, son premier accord à long terme avec un producteur de GNL américain. Edison et le Sefe allemand ont signé des accords similaires. Il en résulte une dépendance structurelle vis-à-vis du gaz américain, qui est non seulement plus cher mais a également une empreinte carbone beaucoup plus élevée que le gaz russe acheminé par pipeline pour les décennies à venir. C’est un exemple classique de vassalité géopolitique.
Mais les choses empirent. Alors même que l’Europe est sommée de couper tous les liens avec l’énergie russe, des rapports font état de pourparlers secrets entre ExxonMobil et la compagnie pétrolière russe Rosneft sur la reprise de la coopération sur l’énorme projet Sakhaline en Extrême-Orient russe. Si cela se confirmait, cela signifierait que, alors qu’il est interdit aux Européens d’acheter du gaz et du pétrole russes bon marché, les entreprises américaines se préparent tranquillement à revenir. L’objectif, semble-t-il, est d’acheter de l’énergie russe à bas prix, de la revendre à un prix élevé et de pousser des concurrents comme la Turquie et l’Inde hors du jeu.
Il y a pourtant un défaut évident dans cette stratégie. Il est difficile d’imaginer que les entreprises américaines reprennent réellement leurs activités avec la Russie alors que la guerre se poursuit — d’autant plus que Washington menace la Russie et ses principaux partenaires, la Chine et l’Inde, de sanctions de plus en plus sévères. En effet, le PDG d’Exxon a démenti les rumeurs. Cette contradiction met en évidence les limites de l’approche transactionnelle de Trump : la conviction qu’il peut parfaitement séparer l’économie de la politique, conclure des accords commerciaux avec Moscou tout en remettant en question les objectifs sécuritaires et géopolitiques plus larges de la Russie.
Pendant tout ce temps, la volonté de dissocier l’Europe de l’énergie russe n’a fait que renforcer le partenariat stratégique entre Moscou et Pékin. En début de mois, ils ont signé un mémorandum pour construire le pipeline Power of Siberia 2, un projet de 13,6 milliards de dollars s’étendant sur 2 600 kilomètres à travers la Mongolie. S’il est confirmé, il fournira 50 milliards de mètres cubes de gaz par an à la Chine, offrant à Pékin une source fiable d’énergie bon marché.
Pour l’Europe, c’est un désastre. Après s’être volontairement coupé de l’énergie russe, le continent est désormais engagé dans un avenir de prix élevés et de faible compétitivité. La Russie, en revanche, s’assure des marchés à long terme en Asie. Le nouveau pipeline aura également des implications pour les États-Unis. Les analystes prédisent que le pipeline provoquera un « choc structurel« sur le commerce mondial du GNL, réduisant la dépendance de la Chine à l’égard des cargaisons maritimes et sapant les ambitions américaines de contrats à long terme.
Mais cela ne fait que souligner pourquoi il est impératif pour les États-Unis de maintenir leurs États clients aussi dépendants que possible des combustibles fossiles américains. Vue sous cet angle, la guerre n’a été rien de moins qu’un triomphe pour les États-Unis : garantir des profits exceptionnels à ses entreprises énergétiques et lier de plus en plus étroitement l’Europe à ses priorités géopolitiques. En effet, il est difficile d’éviter le soupçon que ce résultat faisait partie de l’objectif depuis le début. Après tout, créer un fossé permanent entre l’Europe et la Russie tout en sécurisant l’Europe en tant que marché captif pour l’énergie américaine est sans doute un objectif constant de la stratégie américaine depuis des décennies.
En adoptant des sanctions conformes aux exigences de Trump, Bruxelles sacrifie ce qui lui reste d’autonomie. Le résultat est un paradoxe géopolitique si tordu qu’il défie presque l’entendement. Les gouvernements européens, piégés par leur propre rhétorique et par un engagement dogmatique en faveur d’une confrontation permanente avec Moscou, se sont coincés dans une position risible. Ils ont permis à Trump de présenter ses demandes comme une contrepartie perverse : il peut présenter l’automutilation économique de l’Europe et sa dépendance croissante à l’énergie américaine comme le prix à payer pour accélérer son propre déclin stratégique.
Dans l’ensemble, la politique énergétique de l’UE depuis 2022 est un cas d’école d’automutilation. En se coupant des approvisionnements russes bon marché, elle a offert aux États-Unis une opportunité unique de dominer le marché européen de l’énergie. En adoptant des sanctions, qui n’ont pas réussi à affaiblir la Russie mais ont dévasté l’industrie européenne, Bruxelles a transformé le continent en un pion géopolitique. Les dirigeants européens prétendent défendre les valeurs et la solidarité ; en réalité, ils président à un processus de désindustrialisation et de déclin, tout en continuant à intensifier dangereusement les tensions avec la Russie. À moins d’un changement radical, l’avenir du continent sera celui de la stagnation, de l’insignifiance et, au pire, d’une guerre totale.
Thomas Fazi pour le Saker Francophone.


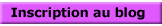
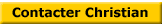
Suivre @ChrisBalboa78