
Si le général de Gaulle voyait ce qu’il est advenu de sa chère V ème République, il serait probablement atterré !
A quelqu’un qui faisait état de l’importance du Conseil constitutionnel, il avait vertement rétorqué :
« la Cour suprême, en France, c’est le peuple ! »
Et il ne manquait jamais l’occasion de rappeler que la Justice n’est pas un « pouvoir » mais une « autorité » !
Mais aujourd’hui, à coup de jurisprudence et de législation européenne, la Justice, avec son empilement de cours de justice, du Conseil d’état français à la Cour européenne des droits de l’homme, a pris les pleins pouvoirs !
Dans l’absolu, cet « état de droit » pourrait renforcer la démocratie dans un meilleur équilibre des pouvoirs mais il n’en est rien ! Car cette justice est largement marquée à gauche et imprégnée par l’idéologie progressiste.
Ce pouvoir des juges a eu des conséquences catastrophiques
en matière de politique en vue de maitriser de l’immigration !
Ce biais idéologique de la Justice, additionné à celui de la majorité des médias, explique largement que la gauche se maintienne au pouvoir alors que le pays est largement à droite !
La revue Polemia, dirigée par Jean-Yves Le Gallou, organise chaque année le Forum de la dissidence. Cette année, le thème du forum était :
« Gouvernement des juges, quel bilan ? Quelle légitimité ? »
Polemia vient de publier, sur son site, un excellent article reprenant l’intervention d’un professeur des Universités, agrégé de droit public, Frédéric Rouvillois.
Je vous propose de relayer, en plusieurs parties, cet article consacré au pouvoir des juges. La première partie sera un rappel du pouvoir des juges au fil de l’histoire.
Comment remédier au gouvernement des juges ?
Partie 1 : Rappel historique
Commençons par un constat : lorsque l’on confie à une juridiction le soin de contrôler la conformité des lois à la constitution, il semble à peu près inévitable qu’apparaisse ce que l’on appelle aujourd’hui le « gouvernement des juges »: c’est-à-dire, l’intervention massive de cette juridiction dans des affaires politiques qui en principe ne relèvent que du souverain ou de ses représentants directs.
1) Inévitable
On ne peut même pas parler de dérive pour désigner ce qui constitue un phénomène certain, cette captation ne se produisant pas seulement lorsqu’on attribue un tel pouvoir aux juges, mais aussi, lorsqu’on se contente de leur reconnaître un pouvoir qu’ils se sont adjugés à eux-mêmes de leur propre initiative. À ce propos, on évoque généralement le fameux arrêt de Marbury contre Madison[1] à l’occasion duquel la Cour suprême des États-Unis va s’attribuer, en 1803, le pouvoir de contrôler la conformité des lois à la Constitution fédérale, qui ne lui avait pas été expressément conféré à l’origine.
Mais on pourrait évoquer aussi, s’étalant sur une période beaucoup plus longue, le cas des Parlements d’Ancien régime qui, entre le Moyen-âge et la Révolution, constituent les plus hautes juridictions du Royaume[2]. Or, dès le XIVe siècle, celles-ci se sont reconnu, parallèlement à un rôle d’interprétation[3] des lois, une fonction de vérification de celles-ci. En vertu de ce pouvoir, les parlements pouvaient refuser d’enregistrer les lois, ce qui signifiait que celles-ci ne pouvaient être appliquées dans le ressort du Parlement en question. Sans doute le roi conservait-il le dernier mot, disposant-on y reviendra plus loin- des moyens de contraindre les Parlements à enregistrer ses lois, et donc, à les rendre applicables. Pour autant, ce pouvoir n’en était pas moins considérable : dès la fin du XVe siècle[4], il conduit les Parlements à se qualifier de « cours souveraines », alors même que la souveraineté appartient au roi et à nul autre. Mais les Parlements tiennent à faire comme s’ils étaient effectivement souverains, et il arrive souvent que les représentants du monarque, sinon les rois eux-mêmes, soient obligés de les remettre à leur place[5]. À la même époque, le grand juriste Etienne Pasquier s’étonne des prétentions de ces « cours qui portent le titre de souveraines », en rappelant que « grande est l’autorité d’une cour souveraine, mais non telle qu’elle soit au-dessus de la loi[6] ».
Et tel est bien le problème : en prenant ce titre, les cours prétendent faire ce qui, selon Jean Bodin, appartient en propre au souverain, faire et casser la loi[7]. Et par là même, gouverner. C’est pourquoi Louis XIV, un siècle plus tard, leur défendra expressément de se qualifier ainsi : elles ne sont, selon l’ordonnance civile de 1667, que des « cours supérieures ». Les Parlements obtempèrent, mais ils reprendront ce titre très significatif dès après la mort du roi en 1715. Ce titre, mais aussi et surtout, ces prétentions[8], comme le leur reprochera Louis XV en 1766[9] , puis le chancelier Maupéou en 1770, à propos de l’édit de discipline : le roi « juge les avantages et les inconvénients de la loi. S’il commande alors, vous lui devez la plus parfaite soumission. Si vos droits s’étendaient plus loin, si votre résistance n’avait pas un terme, vous ne seriez plus ses officiers, mais ses maîtres ; sa volonté serait assujettie à la vôtre ; la majesté du trône ne résiderait plus que dans vos assemblées ; et, dépouillé des droits les plus essentiels de la couronne,(…) le roi ne conserverait que le nom et l’ombre vaine de la souveraineté[10] » En 1774, Ce dernier évoquant les rapports entre les parlements et la monarchie, parlait d’« un procès qui dure depuis trois-cents ans[11] ». Autrement dit, depuis que les parlements ont été en mesure de se saisir de ce pouvoir, et de prétendre participer au gouvernement de l’État.
Or, ce que montre l’histoire du Royaume de France et celle de l’Europe médiévale, on le retrouve de nos jours dans des systèmes « modernes » et démocratiques, des États-Unis à la Grande-Bretagne, à la Pologne ou à Israël.
Pourquoi une telle constance ? Montesquieu nous en dit quelque chose lorsqu’il affirme que « c’est une expérience éternelle, que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser [12] ». Pour ce qui nous intéresse, on pourrait ajouter que les mêmes mécanismes et les mêmes logiques produisent les mêmes effets. Les mêmes mécanismes, c’est-à-dire, la fonction d’interprète de la règle dévolue au juge par la nature même de son office : si en effet on lui reconnaît le pouvoir de contrôler la conformité de la loi à la constitution, cette fonction implique qu’il interprète, autrement dit, qu’il détermine la signification de la loi qu’il contrôle, et en parallèle, celle de la Constitution au regard de laquelle il la contrôle. Or, ce rôle est d’autant plus considérable que la constitution est généralement rédigée de façon concise et en termes très généraux – ce qui va conférer au juge une marge de manœuvre importante, encore accrue par sa situation spécifique au sommet de la hiérarchie juridictionnelle, qui garantit que son interprétation ne sera ni contrôlée ni remise en question par un organe supérieur. En lui attribuant ce rôle de contrôleur incontrôlé, la constitution autorise le juge constitutionnel à déterminer librement sa signification.
Dans ces conditions, comment imaginer, après avoir relu les mots de Montesquieu, que le juge constitutionnel ne sera pas tenté, – sans doute pour de forts bonnes raisons : « Qui le diroit ! la vertu même a besoin de limites[13] » – d’abuser, un jour ou l’autre, du pouvoir qu’on lui offre. Et de justifier son impérialisme en assurant qu’à travers lui, c’est authentiquement la loi, et non l’homme, qui gouverne. Qu’il est juste qu’il exerce le pouvoir, puisqu’il le fait au nom de la justice et du droit.
En somme, dès lors qu’il existe une constitution, et un juge chargé de garantir son respect par la loi, l’évolution vers le gouvernement des juges semble pratiquement inévitable, et elle emprunte presque toujours les mêmes voies[14] . La question qui se pose alors est très simple : est-elle remédiable ?
2) Irrémédiable ?
Sur ce plan, il y a au moins un remède incontestable : l’existence, au sommet de l’état, d’une volonté politique suffisamment forte et déterminée pour inhiber les tentations ou les ambitions des juges.
C’est ce à quoi procède Louis XIV dès le début de son règne, en constatant que les limitations établies par des ordonnances successives, notamment l’Ordonnance de Moulins de 1566[15] ou celle de 1629 sur l’application des lois, n’était pas respectées : il entreprend alors de « mater les cours souveraines[16] » à travers l’ordonnance civile de 1667, puis la déclaration du 23 février 1673, qui réservent le droit de remontrance aux cours souveraines, qualifiées désormais de cours supérieures, de façon limitée et encadrée, des sanctions privées et publiques assurant le respect de ces dispositions. Le résultat, c’est que sous son règne, les remontrances, et donc la possibilité de refuser d’enregistrer les ordonnances et d’empêcher leur application, furent « comme abolies », ainsi que le roi le note dans ses Mémoires[17]. « Les bruits de Parlement ne sont plus de saison[18] », se réjouit Colbert en 1679.
Dans un contexte totalement différent, c’est également ce à quoi procède Franklin Roosevelt au lendemain de sa réélection en 1937. Jusqu’à cette date, la Cour suprême des États-Unis s’opposait de façon systématique à la législation keynésienne adoptée dans le cadre du New Deal à l’initiative du président : face à ces rebuffades, Roosevelt agite la menace d’une réforme en profondeur de la cour[19] qui préfère céder, se soumettre et renoncer à la « souveraineté judiciaire[20] ».
On ne résiste pas à un homme fort, même si, sur un plan juridique, on est persuadé qu’il a tort : c’est ce que montre le Conseil constitutionnel sous la présidence du général De Gaulle de 1959 à 1969, avec comme exemple typique la décision du 6 novembre 1962[21] : si, sur le fond, Le Conseil ne doute pas du caractère irrégulier de la procédure suivie par le Général – le recours au référendum de l’article 11 pour procéder à une révision de la Constitution -, il préfère prudemment « botter en touche » en se déclarant incompétent pour contrôler la constitutionnalité d’une loi référendaire – afin de ne pas subir les foudres présidentielles ni se voir accusé de s’opposer au peuple souverain. Le lendemain matin, à la fin du Conseil des ministres, le Général se frotte les mains : « la loi référendaire est réglée : Le Conseil constitutionnel a évité de commettre une bêtise[22]. »
Lorsqu’il se trouve face à une personnalité dotée d’une légitimité incontestable et prête à tout pour imposer son projet, le juge est amené à se soumettre – plutôt qu’à de se démettre ou à provoquer une crise révolutionnaire. Toutefois, ce remède politique est aléatoire -puisqu’il suppose l’apparition d’un chef suffisamment déterminé-, et temporaire : dès la mort de Louis XIV en 1715, les parlements réaffirmeront leurs ambitions[23] ; dès 1971, le Conseil constitutionnel osera se placer dans la position d’un juge qui gouverne, ou du moins, qui réinterprète la constitution pour censurer les lois qui lui déplaisent.
Le problème est donc de savoir s’il existerait des remèdes juridiques, qui auraient, contrairement aux remèdes politiques, l’avantage d’être à la fois certains et pérennes.
Parmi ces remèdes, certains se situent en amont de la fonction du juge : ils s’avèrent en général d’une efficacité limitée. D’autres, plus pertinents, se situent en aval de la fonction du juge, et se ramènent à la possibilité de remettre en cause, après coup, une décision prise par celui-ci.
Polemia.
[1] Marbury v/ Madison ( 5 US ( 1 Cranch) 137 ( 1803), trad. fr. in É. Zoller, Grands Arrêts de la Cour suprême des États-Unis, PUF, 2000, p. 73.
[2] À la fin du XVIIIe siècle, celles-ci sont au nombre de dix-sept : outre le Parlement de Paris, on peut citer les parlements de Toulouse, d’Aix, de Rouen, de Rennes, de Dijon, de Bordeaux, de Grenoble, de Pau, de Metz, de de Besançon, de Douai, de Nancy, plus les conseils souverains d’Artois, d’’Alsace, du Roussillon et de Corse.
[3] Cette fonction d’interprétation des lois permet aux juges de déterminer le sens de la règle qu’ils appliquent, et qui fait d’eux des co-législateurs permanents : « habitude bien ancrée » à laquelle la monarchie française commence à réagir dès la fin du Moyen-âge, comme le décrit Jacques Krynen dans L’idéologie de la magistrature ancienne ( Paris, Gallimard, Bibliothèque des Histoires, 2009, pp.139 ss) – mais en vain : « Sous François 1er, l’impopulaire chancelier Poyet se berçait d’illusions lorsqu’il déclarait, à propos des ordonnances contenues dans l’acte de Villers-Cotterêts dont il avait été le rédacteur, qu’une fois décrétées par le roi, il n’appartiendrait à aucune cours d’interpréter ni y ajouter ou diminuer » ( p. 152). Les rappels formulés par les chanceliers « à la stricte application des lois » ( ibidem, p. 153) se succéderont tout au long du XVIe et du XVIIe siècle, jusqu’à « l’attaque massive placée au tout début de l’ordonnance civile de 1667 » ( p. 155). De notre point de vue, l’un des intérêts de l’ordonnance de 1667, c’est son absence de nouveauté : dans tous les pays d’Europe, on retrouve le même type de conflit entre le législateur et le juge, et les mêmes prohibitions : « C’est uniquement dans la forme que l’interdiction d’interpréter proclamé par Louis XIV en 1667 se distingue de toutes les autres (…) Quant au fond (…) Pussort avait bien raison, pour se défendre de toute accusation de nouveauté, de faire observer (…) « qu’il n’y a pas un article qui ne trouve son exemple dans les anciennes ordonnances » (cité ibidem, p. 157).
[4] Cf. F. Olivier Martin, Histoire du droit français des origines à la révolution, Paris, Domat, 1948, p. 528: l’auteur note que Louis XI utilisa fréquemment cette expression.
[5] C’est ce que fait par exemple, sur un ton très vif, le chancelier Michel de l’Hospital devant le Parlement de Normandie en 1563 : « Vous jurez (…) de garder les ordonnances (…) ( Mais) les gardez-vous bien ? La plupart d’entre elles est mal gardée ». Vous faites « ainsi qu’il vous plaît (…) Vous dites être souverains 🙁 mais) l’ordonnance est le commandement du roi, et vous n’êtes pas par-dessus le roi. (…) Le roi fait une ordonnance, vous l’interprétez, vous la corrompez, vous allez au contraire » (Harangue prononcée à Rouen le 17 août 1563, in Harangues de Michel de l’Hospital, Paris, A. Boulland, 1825,t. II, p. 67-68)
[6] Estienne Pasquier, « Lettre à Monsieur Robert avocat à la cour du Parlement de Paris », Œuvres, Amsterdam, compagnie des libraires, 1723, t. 2, p. 579.
[7] J. Bodin, Les Six livres de la République, L. I, chap. X.
[8] Les parlements, considérant que les États généraux ne sont plus réunis, vont se faire les interprètes et les défenseurs des contribuables ( A. Esmein, op.cit., p. 601). Sur un autre plan, ils vont théoriser leur pouvoir de vérification des ordonnances, allant, note encore Esmein, jusqu’à contester la régularité des lits de justice, qu’ils estiment « contraires à ce qu’ils appellent les principes fondamentaux de la monarchie » ( Ibidem, p. 602)
[9] Le 3 mars 1766, lors de la « Séance de la flagellation », Louis XV s’oppose à l’idée selon laquelle « les parlements coopèrent avec la puissance souveraine dans l’établissement des lois ; (…) ils peuvent quelquefois par leur seul effort s’affranchir d’une loi enregistrée et la regarder à juste titre comme non existante ; (…) ils doivent opposer une barrière insurmontable aux décisions qu’ils attribuent à l’autorité arbitraire et qu’ils appellent des actes illégaux, ainsi qu’aux ordres qu’ils prétendent surpris, et (…), s’il en résulte un combat d’autorité, il est de leur devoir d’abandonner leurs fonctions et de se démettre de leurs offices, sans que leurs démissions puissent être reçues. »
[10] Cité F. Olivier-Martin, Histoire du droit français op.cit., p. 665.
[11] Ibidem, p. 666.
[12] Montesquieu, L’Esprit des lois, livre XI, chapitre IV : « Pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. »
[13] Ibidem.
[14] En ce qui concerne le Conseil constitutionnel, la technique dite de la conformité sous réserve, qui lui permet d’affirmer qu’une disposition législative est conforme à la constitution à condition de respecter certains points qu’il va lui-même déterminer, constitue l’un des principaux instruments de sa puissance : le juge n’est plus contraint par une alternative binaire, conforme ou non conforme, il a la possibilité de déterminer lui-même la manière dont la loi doit être interprétée et appliquée. Ce faisant, il participe directement à l’élaboration de celle-ci. Or, cette technique, que le Conseil constitutionnel va utiliser dès sa création, en 1959, était déjà employée, dès le Moyen-âge, par les Parlements : ces derniers acceptaient dans certains cas d’enregistrer une ordonnance après « corrections ou modifications » : « c’était l’acte le plus grave, car les magistrats se substituaient (au roi), faisaient la loi à sa place et autrement qu’il ne voulait. » ( J. Declareuil, Histoire générale du droit français, Paris, Sirey, 1925, p. 898) : l’ordonnance de Blois, en mai 1579, réprouva expressément cette technique, et c’est ce que fera à nouveau le Tiers-état à l’occasion des États généraux de 1614, protestant contre des modifications à des lois qui résultaient de ses vœux. Mais ces protestations réitérées ne mettront pas fin à cette pratique.
[15] Après la mort de Henri III, dans le contexte des guerres de religion, le Parlement de Paris, note Adhémar Esmein, « exerce véritablement l’autorité souveraine, conjointement avec le duc de Mayenne, le Lieutenant général », y compris en ce qui concerne la levée des impôts et les fonctions de police. ( A. Esmein, Cours élémentaire d’histoire du droit français, Paris, Sirey, 11e édition, 1912, p. 596.)
[16] J. Declareuil, Histoire générale du droit français, op.cit., p.811
[17] Ibidem, p. 812. Michel Antoine, dans « Les remontrances des cours sous le règne de Louis XIV ( 1673-1715) », Bibliothèque de l’École des Chartes, n° 151-1, 1993, pp. 87-122, nuance toutefois cette approche .
[18] F. Olivier-Martin, op.cit., p. 548. L’Ordonnance de 1667, remarque Jacques Kynen, avait été « voulue par Colbert dans le souci très politique (…) de faire barrage à cette « entreprise ordinaire contre l’autorité royale, qui est tellement tournée en habitude qu’il n’y a pas de petit conseiller de compagnie, appelée abusivement souveraine, qui ne croit être en droit et qui ne juge tous les jours contre les termes précis des ordonnances, et ainsi surprendre et s’arroger la puissance législative dans ce Royaume, qui réside en la personne seule du souverain » » (J. Krynen, L’Idéologie, op.cit., p. 155).
[19] Le 5 février 1937, Roosevelt, tout juste réélu, annonce son intention de faire voter un Judicial Procedures reform bill. Ce « Court-Packing Plan » aurait permis au Président de nommer un juge supplémentaire pour chaque juge siégeant à la cour et ayant dépassé l’âge de 70 ans – soit six nouveaux, ce qui aurait suffi à renverser la majorité en sa faveur. L’objectif de ce plan, explique Roosevelt le 9 mars 1937 au cours d’une émission radiodiffusée, « n’est pas d’attaquer la cour, mais de la remettre à sa place légitime et historique au sein de notre système constitutionnel ».
[20] Dès le 29 mars, elle rend l’arrêt West Coast Hotel Co. v. Parrish, 300 U.S. 379 (1937) reconnaissant la constitutionnalité de la législation sur le salaire minimum.
[21] Décision n°62-20 DC, 6 novembre 1962.
[22] R.Belin, Lorsqu’une République chasse l’autre, Paris, Michalon, 1999, 233
[23] Cf. A. Esmein, op.cit., p. 599-600 : sitôt après la mort de Louis XIV, son testament est écarté par le Parlement de Paris en tant qu’il prévoit que les décisions du Conseil de régence seront prises à la majorité, et qu’il prive ainsi le Régent du pouvoir effectif. En échange, si l’on peut dire, la Déclaration royale du 15 septembre 1715 restaure le Parlement dans ses droits en ce qui concerne l’enregistrement et les remontrances, évoquant « l’ancienne liberté dans laquelle nous le rétablissons ».
A suivre …


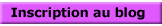

Suivre @ChrisBalboa78

