
Habituellement, on dit qu’il faut regarder ce qui se passe aux Etats-Unis pour savoir ce qui va arriver en France quelques années plus tard ! Avec Internet et les réseaux sociaux, ce serait même quelques mois plus tard !
Et ce qu’on observe en ce moment aux Etats-Unis, le mouvement Black Lives Matter, le wokisme et la Cancel culture ne peuvent que nous inquiéter !
Certains nous rétorqueront que nous n’avons qu’à nous en prendre à nous-mêmes puisque certaines de ces théories sont inspirées d’idées venues de France et connues sous le nom de French Theory.
Romain Delisle, sur le site de l’Institut de Recherches Économiques et Fiscales (IREF), nous rappelle d’où vient la French Theory :

De gauche à droite et de bas en haut : Gilles Deleuze, Jacques Lacan, Jacques Derrida, Jean-François Lyotard, Jean Baudrillard et Michel Foucault.
La french theory, aux racines du venin de la déconstruction
En mai 2017, Caroline de Haas, présidente de la très influente association « Osez le féminisme », ancienne conseillère de Christiane Taubira et candidate malheureuse aux élections législatives dans le 18e circonscription de Paris, déclarait que la solution pour mettre fin au harcèlement des migrants vis-à-vis des femmes dans le quartier de la Chapelle-Pajol était d’élargir les trottoirs.
Le ridicule de la situation et l’accumulation des vices de la pensée n’étant visiblement pas remonté jusqu’au cerveau de l’intéressée, il apparaît opportun de se demander comment l’esprit occidental a pu tomber aussi bas. Tout remonte en fait aux années soixante.
Qu’est que la French theory ?
La French Theory ou post-modernisme français, se définit, selon François Cusset, par un certain nombre de concepts partagés, mais pas comme une école de pensée unifiée : « La triple critique du sujet de la représentation et de la continuité historique, une triple relecture de Freud, Nietzsche et Heidegger et la critique de la critique elle-même » [1] en sont les éléments de cadrage.
Concrètement, il s’agit d’un corpus postmoderne de théories philosophiques, littéraires et sociales, où la notion de déconstruction tient une place centrale. Comme les sept plaies de l’Égypte, les études de genres (gender studies), culturelles (cultural studies) et postcoloniales (postcolonial studies) vont s’abattre sur une université déjà sclérosée par mai 68.
Les Cultural studies sont basées sur une invalidation des thèses marxistes orthodoxes : « la culture n’est pas un simple reflet superstructurel mais un champ de lutte pour l’hégémonie (d’où une référence forte à Gramsci) ; la classe sociale elle-même n’est pas un donné historique brut mais une construction symbolique » [2]. D’où la possibilité, pour la gauche, de mettre en avant les communautés prétendument opprimées, déplaçant ainsi leur clientèle de la working class blanche aux minorités diverses et aux catégories sociales les plus favorisées.
Les Post-colonial studies consacrent l’irruption des thèses ethnicistes et communautaires au sein de l’Université. Pour François Cusset, elles sont la « combinaison d’une trame foucaldienne, où le sujet se construit d’abord par assujettissement aux institutions de contrôle et au discours dominant, et d’une thématique deleuzienne, celle d’un sujet démultiplié le long de fuites nomadiques » [3]. La question afro-américaine a, naturellement, été la référence de ses études mais d’autres catégories de populations ont pu en être l’objet : latinos, amérindiens, asiatiques, femmes ou homosexuels. Le concept est démultipliable à l’infini.
Enfin les gender studies, inspirés du féminisme universitaire, définissent pour la première fois la sexualité de l’individu comme une part et même comme la référence de son identité. En 1960 est ouvert le premier département de Women’studies à l’université d’État de San Diego et dans les années 70 et 80, 300 programmes similaires sont créés dans les universités américaines. L’ouvrage pionnier de Kate Milett, Sexual politics, définit la doctrine qui, aujourd’hui encore, infuse son âcreté dans l’esprit public de notre pays, à savoir : « réhabiliter la contre-histoire de l’oppression des femmes […] et traquer dans les classiques littéraires (au profit d’un corpus de femmes) la misogynie sous toutes ses formes ».
Ce féminisme universitaire se scinde en deux branches à partir des années 70 : un féminisme de la différence, essentialiste, « qui met en avant l’altérité des destins biologiques et historiques de l’homme et de la femme » [4] et appelle au séparatisme, et un féminisme de l’équivalence, constructiviste, qui nie l’altérité des sexes.
La pénétration outre-Atlantique
C’est dans les années 70 que la French Theory débarque sur les campus américains, dans le terreau favorable des marches des droits civiques, de rébellion étudiante boutonneuse et d’opposition politique « à visée surtout existentielle de l’anticapitalisme militant et de célébration mystique des corps libres et des drogues hallucinogènes » [5]. Ainsi, en 1969 et 1970, on dénombrera 350 grèves étudiantes et 9500 manifestations aux États-Unis, environ 30% des 8 millions d’étudiants y ayant pris part. À l’élan politique des années 60, marqué par les revendications des minorités, succède celui des années 70, lié à la liberté sexuelle et globalement à un individualisme en pleine expansion. Finalement, une sorte d’aboutissement de la société de consommation.
C’est à cette époque qu’apparaissent les premiers samizdats [6] étudiants traitant de sujets comme la déconstruction ou la micro-politique, seize revues au total en une dizaine d’années. Diacritics, revue fondée en 1971 à l’université de Cornell, se fait l’écho des échanges entre Foucault et Georges Steiner, suite à un article du New-York Times où ce dernier le décrivait comme le mandarin du moment. SubStance fondée aussi en 1971 à l’université du Wisconsin, se décrit elle-même comme « le véhicule de la pensée française d’avant-garde ». Entre réseaux universitaires et contre-culturels, la maison d’édition Sémiotext(e), joue un rôle pionnier de diffusion des idées françaises, notamment en ce qui concerne la sémiologie [7].
L’affaire Sokal
En ce début du mois d’octobre 1997 est publié un livre signé de deux physiciens, Alan Sokal et Jean Bricmont, qui, sous le titre d’Impostures intellectuelles, entend dénoncer l’utilisation abusive des sciences dures par les sociologues et les philosophes. Pêle-mêle, l’ouvrage brocarde « le jargon », « la charlatanerie », la « véritable intoxication verbale, le mépris pour les faits et la logique », de la part d’un courant intellectuel présenté comme postmoderniste et caractérisé par « le rejet plus ou moins explicite de la tradition rationaliste des lumières » [8], traitant les sciences de manière relativiste, comme des narrations et sous l’angle des constructions sociales. Les principaux inspirateurs de ce mouvement sont français : Gilles Deleuze, Jacques Lacan, Jacques Derrida, Jean-François Lyotard, Jean Baudrillard, sans oublier l’inénarrable Michel Foucault.
Ce qui a depuis été appelé, « l’affaire Sokal » avait commencé comme une farce : en 1996, Alan Sokal, professeur de physique à l’université de New York, avait soumis un article pseudo-scientifique à la revue Social Text, sous le titre « Transgresser les frontières : vers une herméneutique transformative de la gravitation quantique ».
Le texte prétendait démontrer que la théorie quantique a des implications politiques progressistes et conclut que, puisque la réalité « physique […] est à la base une construction sociale et linguistique », alors « une science libératrice » et « des mathématiques émancipatrices » devraient être développées afin d’abandonner « les canons de la caste d’élite de la science dure » au profit d’ « une science postmoderne [qui] offre le puissant appui intellectuel au projet de politique progressiste ».
En somme, et dès le départ, il s’agit de débats propres aux tendances d’un mandarinat de gauche qui, ayant complètement colonisé l’Université, impose des lignes de fractures qui concernent uniquement sa propre sphère de pensée. Pour schématiser, le clivage s’organise entre la gauche traditionaliste, héritière des lumières, du rationalisme et de la pensée universelle, et la gauche déconstructioniste dont chaque -isme porte le nom de tel ou tel groupe ou catégorie supposée opprimée de manière systémique.
[1] François Cusset, « French Theory », La découverte poche, Collection sciences humaines et sociales, 2005, p.19.
[2] Ibid, p.145.
[3] Ibid, p.150
[4] Ibid, p.158.
[5] Ibid, p.65.
[6] Ouvrage diffusé clandestinement, à l’origine, sous forme polycopiée ou ronéotypée, synonyme d’une feuille de choux.
[7] Science des systèmes de signes (intentionnels ou non) et des systèmes de communication.
[8] Alan Sokal et Jean Bricmont, Impostures intellectuelles, Paris, Le livre de poche, coll. « Biblio essais », 1999 [1997], p. 38-40, 33 et 36.
Romain Delisle pour l’IREF.


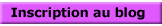

Suivre @ChrisBalboa78
